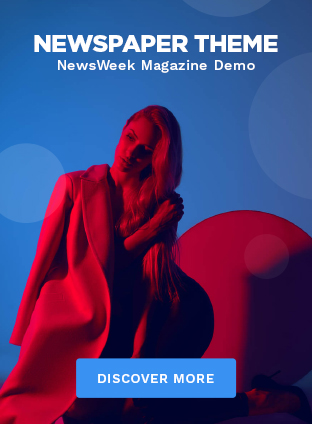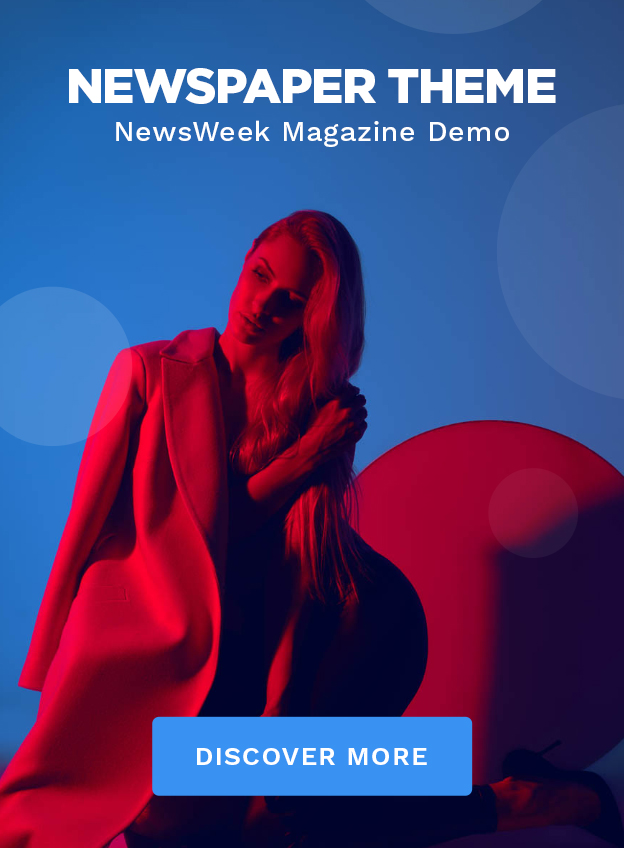Le vélo lui a « sauvé la vie », confesse Eyeru Tesfoam dans un large sourire. Un brin mélancolique, l’Ethiopienne, qui s’apprête à concourir lors des Jeux olympiques de Paris dans l’épreuve de cyclisme sur route, revient de loin. Elle le fera non pas sous les couleurs de son pays, mais sous la bannière de l’équipe olympique des réfugiés. Elle a été à ce titre désignée pour porter la flamme olympique à Bayeux, le 30 mai.
La cycliste de 27 ans vit en France, trois ans après avoir fui sa région natale du Tigré, alors théâtre d’une guerre civile (2020-2022) qui a fait plus d’un demi-million de morts. Parmi eux, certains de ses proches. Réfugiée près de Nancy, coureuse au sein de l’équipe Komugi-Grand Est, elle refuse désormais d’évoquer cette époque marquée par le sceau de l’horreur.
Originaire de la ville d’Aksoum, au Tigré, Eyeru Tesfoam s’est mise au cyclisme sur le tard, à 16 ans, à l’instar d’autres adolescentes éthiopiennes. « Pour les filles, c’est compliqué, il y a peu de vélos et ça coûte cher. Personnellement, je viens d’une famille modeste et je ne pouvais pas me permettre d’être un poids pour ma mère », dit la jeune femme, décrivant ici l’une des principales barrières à l’accession des femmes au sport de haut niveau sur le continent. Au moment de s’orienter vers le cyclisme plutôt que vers l’université, sa famille lui a fait comprendre « que ce n’était pas un métier pour femmes et que j’allais gâcher ma vie ».
« Les oubliées du cyclisme »
Aujourd’hui, son pari a réussi, mais Eyeru Tesfoam ne peut totalement démentir sa famille, « parce qu’il n’existe pas vraiment de courses féminines, c’est encore très amateur ». Elle a été repérée lors des Jeux africains en 2016, « la seule vraie épreuve en Afrique ». Par la suite, elle a intégré le Centre mondial du cyclisme de l’Union cycliste internationale (UCI), en Suisse. « Pour nous, Africaines, c’est l’unique chemin pour faire carrière en Europe », explique-t-elle.
En effet, hormis le championnat continental et le Tour du Burundi une fois par an, les femmes n’ont pas de compétition pour se mesurer. « Ça devient impossible pour elles de prouver leur valeur. Ce sont les oubliées du cyclisme », réagit Jean-Pierre Van Zyl, directeur de l’UCI en Afrique, dont le centre d’entraînement basé au Cap, en Afrique du Sud, forme une poignée de cyclistes africaines tous les ans.
« Une seule structure pour 54 pays, c’est loin d’être suffisant », juge l’Américaine Kimberly Coats, directrice d’Africa Rising, une ONG qui entraîne les cyclistes professionnels africains depuis 2007 et milite pour l’expansion de ce sport en Afrique de l’Ouest. « Le manque de ressources est un obstacle évident, l’autre, c’est la culture », accusant les fédérations nationales de « ne laisser que les miettes aux catégories féminines ».
Kimberly Coats a récemment posé ses valises au Bénin, séduite par le projet du célèbre plasticien Romuald Hazoumé, qui a pris le guidon de la Fédération nationale il y a six ans. « On met le paquet sur les filles, s’enthousiasme l’artiste. Dans le cyclisme, c’est avec elles que nous pouvons gagner. On a un vrai potentiel sur route. »
Depuis Porto-Novo, il a trouvé un subterfuge pour permettre aux cyclistes béninoises d’apparaître sur les radars des grandes équipes européennes : « Il n’y a pas de courses en Afrique alors on s’adapte. On fait courir les filles sur des vélos d’appartement connectés, sur des courses virtuelles contre d’autres cyclistes dans le monde. Les données de puissance sont ensuite en ligne et accessibles à tous. »
« Persécutée chez elle »
Du haut de ses 23 ans, Yétondé Kpovihouédé s’exerce sur ces machines Zwift « deux à trois fois par semaine » dans la moiteur de la capitale béninoise, les yeux collés à l’écran de sa tablette. « Mon rêve est d’aller courir en Europe », assure la jeune femme, qui a débuté le vélo il y a seulement deux ans après une première tentative dans l’athlétisme. « Ici nous sommes mieux traitées : le matériel est mis à notre disposition, un salaire nous est versé », résume-t-elle. Ses bonnes performances ont tapé dans l’œil de la fédération, qui l’a sélectionnée pour courir cet été en France sur des épreuves de seconde division, avec le rêve d’être repérée par une structure professionnelle.

L’espoir est mince. Car aujourd’hui, peu d’équipes cyclistes prennent le risque de recruter des coureuses venues d’Afrique. « Obtenir un visa pour de jeunes femmes célibataires est un parcours du combattant que les patrons d’équipes préfèrent éviter », relate Kimberly Coats. Une seule formation a franchi le pas : l’équipe Canyon-SRAM, troisième au classement féminin de l’UCI, a pris sous son aile cinq cyclistes africaines, dont la championne continentale, la Nigériane Ese Ukpeseraye. « Elle était persécutée chez elle, au Nigeria, sous prétexte que ce n’est pas le rôle d’une femme d’être sur un vélo », raconte le directeur de l’équipe, Adam Szabo.
Mais même après leur arrivée en Europe, le parcours des cyclistes africaines n’a rien d’un long fleuve tranquille. « L’adaptation prend du temps, la vie, la langue mais aussi les courses, confie Eyeru Tesfoam. Avant, en Ethiopie, je roulais en plein soleil, sur de larges routes avec vingt concurrentes. Ici, les routes sont étroites, il pleut et le peloton est fourni. » L’émergence de cyclistes africaines au plus haut niveau pourrait s’avérer plus délicate et plus longue que celle des hommes, selon Adam Szabo. « Etonnamment, ce n’est pas une question physique ou technique, mais de mentalité, indique le directeur sportif. En Afrique, les préjugés visant les sportives de haut niveau sont puissants. On a remarqué que les coureuses, quand elles font carrière ici, ont une sorte de culpabilité et manquent d’ambition. »
« L’Afrique en selle » : retrouvez tous les épisodes de notre série d’été