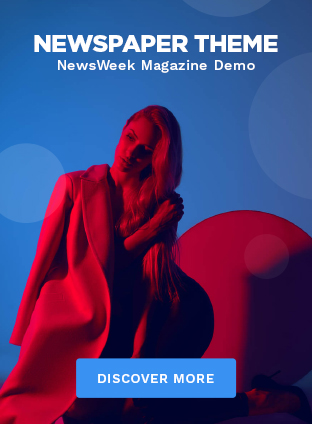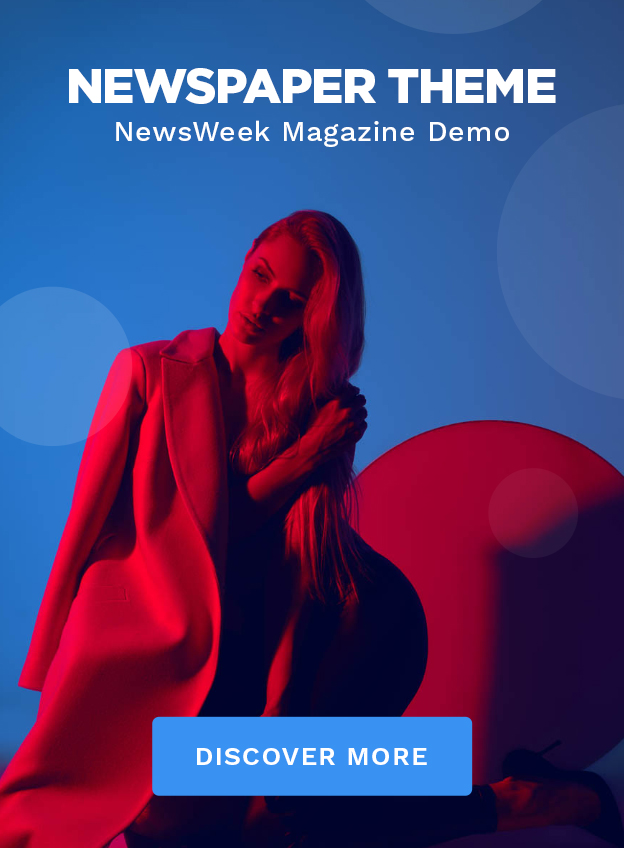« Jamais une campagne électorale présidentielle n’a été empreinte d’une répression aussi implacable. » C’est le constat de Mohcine Belabbas, l’ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui boycotte la présidentielle du 7 septembre en Algérie, après que des dizaines de cadres de son parti, dont son président, Atmane Mazouz, ont été brièvement arrêtés le 20 août. Ceux-ci ont été empêchés d’arriver à Ifri, dans la wilaya de Béjaïa, où ils souhaitaient commémorer le congrès de la Soummam, moment historique de la guerre d’indépendance.
Depuis le début de la répression en juin 2019 du Hirak, ce mouvement populaire qui a provoqué la chute du président Bouteflika, même les enterrements de personnalités sont surveillés afin qu’aucune revendication politique ne puisse y être associée.
La frilosité récente est-elle liée à la campagne électorale ? Harcelés juridiquement depuis qu’ils ont acquis une certaine notoriété durant le Hirak, Karim Tabbou, président de l’Union démocratique et sociale (non agréé), et Fethi Ghares, coordinateur du Mouvement démocratique et social (MDS, suspendu), tous deux opposés au scrutin, sont de nouveau menacés.
Le premier a appris le 19 août que les conditions de son contrôle judiciaire lui interdisaient désormais « de publier des commentaires politiques sur les réseaux sociaux » ou de « participer à des débats politiques ». Interpellé le 27 août puis remis en liberté, sous contrôle judiciaire, deux jours plus tard, le second est poursuivi, avec son épouse, Cheballah Messaouda, pour « offense au président de la République », « publication de fausses informations » et « propagation d’un discours de haine », presque les mêmes accusations qui lui ont valu neuf mois de prison entre 2021 et 2022.
Au moins « 225 détenus d’opinion »
Le plus surprenant est que dans la moiteur des vacances, le président Tebboune se dirige dans l’indifférence vers une réélection. Les débats sont absents des médias, que les autorités ont rendu muets et qui répercutent les appels des trois candidats en lice à voter massivement, mais aussi des réseaux sociaux, sous surveillance.
L’appareil judiciaire ne s’arrête d’ailleurs pas aux cadres politiques. Est-ce ce post Facebook dans lequel Yacine Mekireche s’amuse de l’appel téléphonique passé par le président Tebboune à la gymnaste Kaylia Nemour, tout juste championne olympique, qui lui a valu d’être interpellé le 6 août ? Ou bien cet autre, publié en avril, dans lequel il rend hommage à un garçon tué par la gendarmerie durant le « printemps noir », en Kabylie, en 2001 ?
Ses amis s’interrogent. Le militant du MDS, sous mandat de dépôt, est poursuivi pour « propagation de discours de haine et de discrimination » et « incitation à attroupement non armé », selon le Comité national pour la libération des détenus, collectif qui tient le compte des arrestations. Comme lui, une dizaine d’autres personnes, certaines déjà emprisonnées durant les cinq dernières années, ont été appréhendées depuis quatre semaines à Alger, Oran, Khenchela, Relizane… accusés d’« apologie de terrorisme », de « publication des fausses informations de nature à nuire à l’ordre public et à l’unité nationale » ou encore d’« offense au président ».
« Selon la liste que je tiens, il y a actuellement 225 détenus d’opinion, un chiffre minimum car les familles ont parfois peur de communiquer », explique Zakaria Hannache, militant des droits humains lui-même menacé, en 2022, et aujourd’hui réfugié au Canada. « Depuis trois semaines environ, poursuit-il, j’ai aussi remarqué une hausse du nombre de personnes convoquées pour interrogatoires, ainsi intimidées avant d’être relâchées. »
« Maintenir la pression sur les prévenus »
Depuis juin 2019, les autorités s’appuient sur un arsenal juridique, renforcé en 2021 par l’article 87 bis du code pénal, lequel assimile à du « terrorisme » ou à du « sabotage » tout appel à « changer le système de gouvernance par des moyens non conventionnels ». Une définition « si vague qu’elle laisse aux services de sécurité une grande marge de manœuvre pour arrêter les défenseurs des droits humains », avait regretté auprès du Monde Afrique Mary Lawlor, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, après dix jours de visite en Algérie en novembre 2023. Elle avait alors demandé, comme d’autres organisations, la révision des textes de lois problématiques, admettant qu’il faudrait « probablement attendre la fin des élections » pour espérer des avancées.
Cet arsenal serait néanmoins vain si les juges ne faisaient pas un usage abusif du « mandat de dépôt », mesure exceptionnelle devenue la norme. « Un désastre national », dénonçait l’avocat Miloud Brahimi, en 2022, qui permet de maintenir des individus en prison avant leur jugement.
« Il y a généralement une disproportion manifeste entre les réquisitions et les peines, remarque Massensen Cherbi, docteur en droit de l’université Paris-II Panthéon-Assas, qui a publié en décembre 2023 une étude basée sur des dizaines de décisions judiciaires rendues entre 2019 et 2023. C’est vraisemblablement pour maintenir la pression sur les prévenus, quitte à les relaxer ou à les acquitter ensuite, parfois après de longs mois de détention provisoire. Cela permet surtout de maintenir un climat de peur. »
Suivez-nous sur WhatsApp
Restez informés
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
Plusieurs manifestants porteurs de drapeaux berbères ont ainsi été arrêtés et parfois condamnés, depuis juin 2019, pour « atteinte à l’intégrité de l’unité nationale », avant que la Cour suprême ne confirme en octobre 2022 l’absence d’incrimination à l’égard de cet emblème. « Il existe d’autres mécanismes de pression pour le ministère public, ajoute Massensen Cherbi, comme le fait d’interjeter appel, malgré une première relaxe ou un acquittement, ou de se pourvoir en cassation, ce qui peut maintenir la pression sur un individu deux ou trois ans afin de le “désinciter” à s’exprimer. »