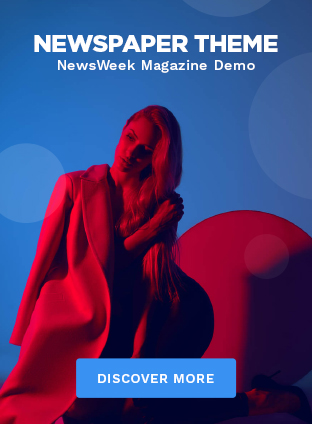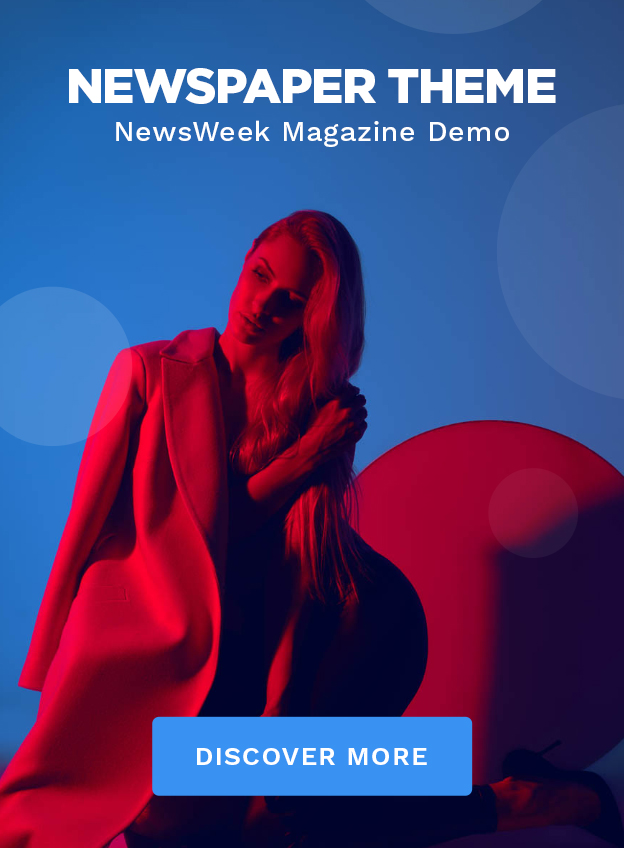Sahle-Work Zewde s’en est allée par la petite porte. La présidente éthiopienne a rendu son tablier, lundi 7 octobre, devant la Chambre des représentants, lors d’une cérémonie expéditive, sans discours et presque ignorée par les médias d’Etat. Une sortie indigne pour cette femme de 74 ans qui a incarné, à son arrivée en 2018, les espoirs d’un renouveau démocratique en Ethiopie aux côtés du premier ministre Abiy Ahmed.
La fin abrupte de son mandat trahit le malaise qui s’est installé entre les deux têtes de l’exécutif éthiopien et l’amertume de la désormais ex-présidente, forcée de déplorer l’échec de la transition dans son pays aujourd’hui dévasté par la guerre.
Aucune raison n’a été avancée pour expliquer cette démission. Pas plus que pour son remplacement immédiat au poste de président – une fonction essentiellement honorifique en Ethiopie – par Taye Atske Sélassié, l’ancien ministre des affaires étrangères. Son mandat de six ans devait pourtant s’étendre jusqu’à la fin du mois d’octobre. Pourquoi un tel empressement ? Sûrement, comme l’avancent plusieurs sources dans la capitale Addis-Abeba, pour éviter que Sahle-Work Zewde ne prononce son discours annuel devant la Chambre des représentants, ce 7 octobre. Une prise de parole qu’aurait pu craindre Abiy Ahmed.
La condition des femmes comme priorité
Le binôme improbable que cette ancienne diplomate a formé avec ce jeune premier ministre issu de l’armée et des services de renseignement s’est progressivement distendu au fur et à mesure du basculement du pays dans la guerre civile.
Encensé à sa prise de pouvoir en 2018, Abiy Ahmed – 41 ans à l’époque – symbolisait la nouvelle génération de dirigeants libéraux, décidés à en finir avec le régime autocratique éthiopien à coups de réformes économiques et d’amnisties accordées à des milliers de prisonniers politiques. La paix signée avec l’Erythrée – après vingt ans de conflit– lui vaudra même le prix Nobel de la paix en 2019.
Du haut de sa fonction symbolique, la présidente – ancienne ambassadrice d’Ethiopie en France – avait fait de la condition des femmes éthiopiennes et de la paix ses deux priorités. « J’ai un pouvoir : celui d’avoir une torche très puissante. Je peux mettre la lumière sur des domaines qui restent dans l’ombre », confiait-elle au Monde en 2019. La même année, elle appelle de ses vœux une renaissance démocratique : « Il y a deux ou trois ans, le pays était au bord du précipice. On a vu le fond de l’abîme : les états d’urgence, les tensions interethniques… On a poussé à outrance cette ethnicité qui a fait qu’on s’est entretués de façon abominable. »
Elle évoque les viols au Tigré
Cinq ans plus tard, le constat est implacable : l’Ethiopie d’Abiy Ahmed a de nouveau plongé dans ce gouffre. D’une violence inouïe, la guerre du Tigré (2020-2022) a fait plus d’un demi-million de morts, selon les estimations de l’Union africaine (UA). « On ne peut pas faire semblant de ne pas voir ou entendre ce qui se passe au Tigré », a-t-elle réprouvé en 2021, en référence aux dizaines de milliers de femmes victimes de viols commis par l’armée éthiopienne, son allié érythréen et les milices venues de la province voisine Amhara. Des crimes que le gouvernement s’acharne alors à dissimuler.
Cette sortie publique, hors des éléments de langage dictés par Addis-Abeba, lui avait valu un discret rappel à l’ordre par un premier ministre en pleine fuite en avant. Abiy Ahmed n’hésitait plus, dans des discours enflammés, à qualifier les Tigréens – environ six millions de personnes – de « mauvaises herbes », ou à souhaiter creuser « une grande fosse dans laquelle l’ennemi [les insurgés tigréens] sera enterré ». Des déclarations aux antipodes de son prix Nobel, qui obligeront Facebook à supprimer ses messages de la plateforme pour « incitation à la violence ».
« Sahle-Work Zewde faisait face à un terrible dilemme. Soit rester présidente et cautionner un régime de plus en plus autoritaire, à l’opposé de ses convictions. Soit démissionner et perdre tout espoir de peser un tant soit peu sur ses orientations », analyse le chercheur indépendant René Lefort. L’intéressée a plusieurs fois pensé remettre sa démission, dévoilent ses proches. « Qu’aurait-elle pu faire de plus dans cette atmosphère tendue, où le moindre appel à la paix était perçu comme une trahison de l’armée ? », s’interroge un membre de son entourage, selon qui elle redoutait même d’être placée sous surveillance dans ses bureaux de la présidence.
Transition manquée
D’autres jugent qu’elle a failli à sa tâche. « Elle aurait pu se faire davantage entendre, elle n’a jamais véritablement pesé sur les événements, même en ce qui concerne la défense des droits des femmes », observe Bizuneh Yimenu, professeur de sciences politiques à l’université Queens à Belfast (Royaume-Uni). Pendant la guerre du Tigré, seule la ministre des Femmes, Filsan Abdi, a démissionné, en raison des viols de masse perpétrés contre les femmes tigréennes.
Suivez-nous sur WhatsApp
Restez informés
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
Isolée, Sahle-Work Zewde s’est lentement recroquevillée sur ses prérogatives symboliques, jusqu’à se réfugier dans le silence depuis un an. Ainsi, deux jours avant sa démission, le 5 octobre, elle écrivait un message sibyllin sur le réseau social X : « Quand l’être humain est bouleversé […] quand il perd son chemin, le silence est le seul espoir […] J’ai essayé cela pendant un an. » Une ultime opportunité de prudemment se démarquer d’un premier ministre va-t-en-guerre. « Si vous décidez de rester silencieuse, vous décidez indirectement de ne pas agir », juge Bizuneh Yimenu.
Avec son départ, une page se tourne en Ethiopie, laissant derrière elle l’impression d’une transition manquée. Sa démission intervient après celles d’autres figures, qui symbolisaient les promesses de changement mais se sont retrouvées incapables de réformer le régime : l’avocate Meaza Ashenafi à la tête de la Cour suprême ; l’ancienne opposante Birtukan Mideksa, présidente de la Commission électorale ; l’avocat Daniel Bekele, qui présidait la Commission des droits de l’homme. Ce dernier a quitté ses fonctions en juillet, au lendemain d’une attaque d’Abiy Ahmed l’accusant de « servir des intérêts étrangers ».
Dans ce pays de 122 millions d’habitants, profondément fracturé par les nationalismes ethniques, seule la capitale Addis-Abeba est un lieu sûr. Les périphéries sont en proie à l’insécurité, aux rapts et aux guérillas. Le 9 octobre, un groupe de 45 pays occidentaux s’est ainsi dit « alarmé par le nombre élevé de violations des droits de l’homme et d’abus commis […] de détentions arbitraires, de meurtres, d’actes de torture, de disparitions forcées, de violences sexuelles », devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies.
Cela est particulièrement vrai en région Amhara, où vivent 36 millions de personnes. L’armée éthiopienne et une milice nationaliste s’y livrent une guerre féroce depuis août 2023. Les autorités y ont arrêté des centaines d’opposants, début octobre. Une nouvelle vague de répression après tant d’autres, devenues difficilement acceptables pour l’ex-présidente. En avril, elle déclarait déjà, dans l’un de ses derniers discours : « On ne peut pas continuer comme ça ». Six mois plus tard, elle a finalement tout arrêté.