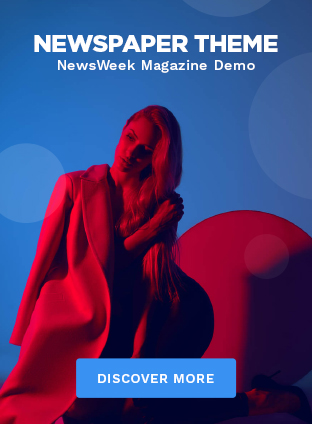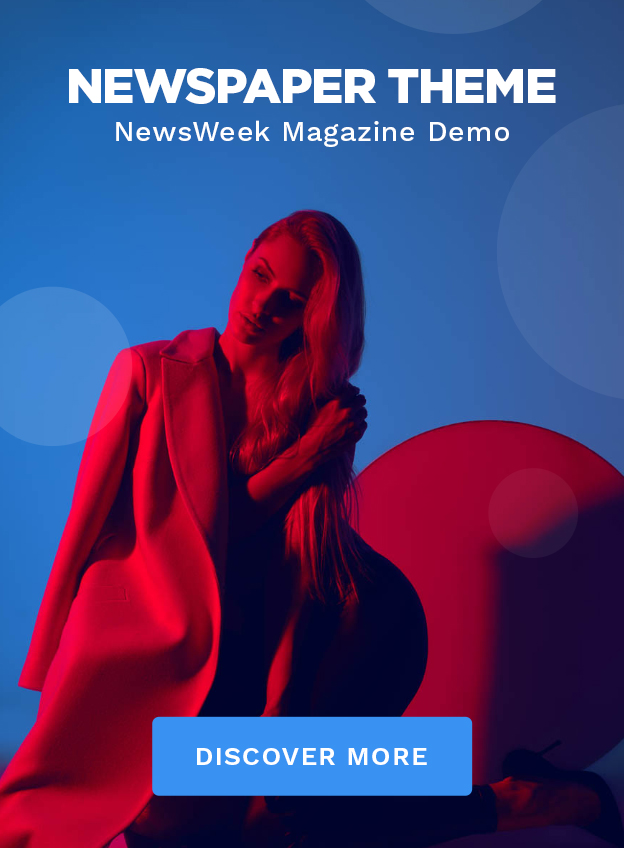Depuis la sortie, en août, de son roman Houris, Kamel Daoud est très sollicité. Dans ce petit bistrot du 18e arrondissement où l’on s’attable pour l’entretien, il touche à peine à son poisson. Trop anxieux à l’idée de rater son train pour Bordeaux, où l’attend une énième vente-dédicace. Depuis l’été, l’écrivain algérien naturalisé français enchaîne les rencontres. Bordeaux, Nancy, Brest, Nice, Marseille, Paris… un vrai tour de France des librairies avant une tournée internationale. Houris fait partie de la première liste de livres sélectionnés pour le prix Goncourt 2024.
Installé en France, l’écrivain et journaliste peut enfin raconter cette histoire qui le hante depuis vingt-cinq ans. Dans les nuits du 30 décembre 1997 et du 3 janvier 1998, des groupes islamiques armés investissent Had Chekala, Ammi Moussa ou encore Ramka, des hameaux isolés de la région de Relizane, pour y massacrer femmes, hommes, enfants, bébés et bêtes. Bilan de ce pogrom ? Plus de 1 200 morts. Vingt-cinq ans plus tard, rares sont les Algériens qui se souviennent de ces deux tueries. Certains n’en ont d’ailleurs jamais entendu parler. La politique de réconciliation nationale décrétée par le président Abdelaziz Bouteflika en 1999 impose silence, oubli et amnésie. Une loi de 2005 interdit même d’évoquer cette tragédie sous peine de poursuites judiciaires – loi qui explique sans doute le refus de l’Algérie d’accueillir les éditions Gallimard au Salon du livre d’Alger.
Au cœur du roman, il y a ces massacres de Had Chekala et cette décennie noire que l’écrivain a choisi d’évoquer à travers Aube, l’héroïne, qui a perdu ses parents, sa sœur, ses proches et sa voix dans cette orgie de sang. Cette nuit-là, alors qu’elle n’avait que 5 ans, un terroriste lui a tranché la gorge, sectionnant ses cordes vocales avant de la laisser pour morte. Elle a survécu, avec un « sourire » de vingt centimètres sous le menton. Revenue des morts, Aube renaît à Oran, y tient un salon de coiffure, raconte le passé et le présent. Le passé, ce sont ces tueries qui ont ensanglanté l’Algérie. Le présent, c’est cet enfant qu’elle porte dans son ventre, à qui elle raconte son histoire, l’amnésie qui entoure cette guerre et l’injustice faite aux victimes, qui doivent vivre avec leurs bourreaux.
Jeune Afrique : Vous êtes journaliste au Quotidien d’Oran, en 1997, quand vous partez couvrir ces massacres de Had Chekala, qui ont fait plus de 1 000 morts. Comment avez-vous vécu ces tueries de masse ?
Kamel Daoud : De permanence ce soir-là, j’apprends par un appel que des massacres ont eu lieu dans la région de Relizane. L’informateur affirme que des centaines de personnes ont été tuées dans ces localités que je connais bien, puisque ma mère en est originaire. Le lendemain, je me rends sur les lieux, où il n’y a ni policier, ni gendarme, ni militaire. À Had Chekala, tout est gris, boueux, sale, sanglant. Partout, un silence sidérant. Et l’hébétude. Les gens errent comme des zombies. Sur les sentiers où le sang se mélange à la boue, il y a de la vaisselle, des couvertures, des tapis laissés par les rescapés qui ont fui les tueurs. Partout, des cadavres et des membres découpés. Ils n’ont pas seulement tué, ils ont aussi dépecé leurs victimes. Je me souviens d’un homme qui m’a agrippé le bras en me disant : « Ils ont pris mes filles, ils ont pris mes filles. » Des dizaines de jeunes filles ont été kidnappées, violées et massacrées.
Comment retranscrire dans un article toutes ces horreurs ?
Sur les lieux, c’est d’abord la sidération. Le cerveau décroche, s’arrête de fonctionner à la vue des centaines de cadavres, dont certains horriblement mutilés. Ensuite, vient la question du nombre de victimes au moment de raconter l’histoire. Le nombre de morts est une question politique. À l’époque, les autorités ont avancé le chiffre de 147 morts alors que les gens évoquaient plus de 1 200 morts. Ce chiffre écrase tout le reste du récit. Vous imaginez 1 200 morts en deux nuits de massacre !
Pour le besoin de ce roman, vous repartez à Had Chekala en juin 2023. Que reste-t-il de ces lieux, de ces vies et de ces tragédies vingt-cinq ans après ?
J’ai tenu psychologiquement grâce à la littérature. Chaque journaliste avait sa stratégie de survie face à l’horreur.
la suite après cette publicité
De tout cela, il ne reste rien. Les hameaux où ces personnes ont été suppliciées sont aujourd’hui des lieux de désolation, de non-mémoire. Les habitants ont repris le cours de leur vie, mais on sent encore l’hébétude et la sidération. Comme le raconte Aube, le personnage de Houris, ces lieux devraient abriter un mémorial, et chaque feuille d’arbre devrait porter le prénom d’une victime. Face au plus grand massacre de cette décennie, on cultive le grand oubli, le grand effacement.
Comment les journalistes qui couvraient ces massacres tenaient-ils psychologiquement ?
On tient avec l’alcool. Ne soyons pas hypocrites. Tout le monde sait qu’à l’époque les journalistes buvaient beaucoup, et certains étaient abîmés par l’alcool. Mais il y avait une sorte d’exaltation et d’excitation du métier qui aidaient à faire contrepoids aux traumas psychologiques. Ce qui est frappant, c’est qu’à l’époque du terrorisme les journalistes allaient sur le terrain. Maintenant que l’on vit dans la paix, personne ne sort de sa rédaction. Le journalisme est devenu sédentaire. J’ai tenu psychologiquement grâce à la littérature. J’avais tout le temps un livre entre les mains. A l’époque, je dévorais les livres de l’écrivain argentin Ernesto Sábato. Chacun avait sa stratégie de survie face à l’horreur.
Pourquoi avez-vous choisi ces tueuries de masse comme thème pour Houris ?
D’abord, c’est une expérience personnelle qui n’est pas passée. Ensuite s’est posée la question des limites de ce qui peut se raconter. Qu’est-ce qu’on peut vraiment dire d’un massacre ? Le journalisme a des limites. Non pas à cause de la censure, mais des limites liées au métier lui-même. Le thème du massacre s’est imposé aussi du fait que cette région est celle de ma mère, une région que j’ai mythifiée quand j’étais enfant.
Had Chekala, c’est aussi mon enfance, le souvenir de mon grand-père et de ses fermes. Et tout d’un coup, tout cela bascule de l’autre côté de la vie pour devenir un cauchemar absolu. Il y a aussi ce chiffre de plus de 1 000 morts qui frappe et sidère. Quand on raconte cela, des gens qui vivent en Occident ne nous croient pas.
Pourquoi attendre plus de vingt ans pour écrire sur cette décennie noire ?
Techniquement, je devais construire une histoire. Humainement, j’avais besoin de temps. Quelqu’un a dit qu’il fallait vingt ans pour raconter une guerre. C’est exactement ce qui est arrivé pour moi. Il m’a fallu deux décennies pour raconter cette guerre civile.
À l’époque, il ne fallait pas divulguer les chiffres des massacres pour ne pas choquer l’opinion algérienne et internationale. Cette politique de réconciliation nationale imposée par le président Bouteflika passe-t-elle aussi par l’amnistie des faits qui est au cœur de votre roman ?
Je n’aime pas cette expression, « réconciliation nationale ». Elle veut dire que le bourreau a demandé pardon à sa victime et que celle-ci le lui a accordé. Nous sommes dans une situation d’amnésie violente et dans un pays dans lequel il y a des chiffres précis sur la guerre d’indépendance, à l’époque où il n’y avait pas d’État. Et nous n’avons pas de chiffre exact sur la guerre civile alors que nous avons un État. Tout le monde évoque 200 000 morts. Dernièrement, l’agence de presse officielle a même évoqué 250 000 morts.
Dans Houris, Aube dit à la fille qui est dans son ventre : « Les chiffres sont la base de la vérité. » Elle est obsédée par l’idée de compter. Nous avons besoin de chiffres sur la guerre de décolonisation pour sortir du mythe et aller vers la vraie mémoire. C’est la même chose pour la décennie noire. En parlant de réconciliation, on ne connaît pas jusqu’à présent les détails des accords qui ont été signés en octobre 1999 par l’AIS [Armée islamique du salut] et l’armée algérienne. Ce sont ces accords qui, en janvier 2000, ont permis à plus de 6 000 terroristes de bénéficier d’une grâce. Cette tragédie aurait pu au moins servir à construire le socle d’un nouveau consensus en Algérie comme ce fut le cas au Rwanda. Il y a une limite de violence au-delà de laquelle, si on n’en assume pas la responsabilité, on ne construira jamais une nation.
La décennie noire est peu documentée en littérature, en documentaire ou en fiction, contrairement à la guerre d’indépendance. Comment expliquer le silence sur une période de bruit et de fureur ?
Il y a d’abord l’arsenal juridique. La loi sur la charte et la paix de 2005 interdit d’évoquer cette tragédie sous peine de poursuites. Toute plainte émanant d’une victime doit être considérée comme irrecevable par un juge. La structure institutionnelle n’existe pas pour autoriser ou rendre possible la collecte des faits. Les gens qui ont subi cela dans leur chair ont un sentiment de peur et de honte. Les bourreaux ne veulent pas parler. Nous avons mal soldé cette période. On a peur de la vérité, peur que l’on dise et que l’on sache qui a fait quoi.
Paradoxalement, c’est après cette guerre civile qu’il y a eu une surenchère mémorielle sur la guerre d’indépendance. Pour faire oublier l’une, rien de mieux que de parler de l’autre.
Pour instaurer un droit à la parole, il faut le soutien de l’État. Au Rwanda, ils ont organisé des séances de réconciliation et de justice dans les stades, des tribunaux populaires dans les villages pour libérer la parole. On aurait pu faire la même chose en Algérie. Peut-être pas la première année, mais on aurait pu suivre le même processus. Ainsi, les islamistes qui n’ont pas demandé pardon en l’an 2000 sont les mêmes qui disent aujourd’hui ne rien avoir fait de mal.
Et au-delà ?
Pour moi, certains Algériens considèrent cette période comme une guerre honteuse. Une guerre où nous nous sommes entretués. Mieux vaut l’oublier. Dans l’autre guerre, l’ennemi était un étranger. Nous pouvions dire que nous étions tous des héros. Dans cette guerre civile, l’ennemi est en nous. Il n’y a pas de héros. Paradoxalement, c’est après cette guerre civile qu’il y a eu une surenchère mémorielle sur la guerre d’indépendance. Pour faire oublier l’une, rien de mieux que de parler de l’autre.
N’y a-t-il pas dans cette guerre civile, comme dans Houris, une double violence ? Celle produite au moment des faits et celle de côtoyer les bourreaux, libres et arrogants ?
Dans certaines administrations, victimes et bourreaux vivent et travaillent côte à côte. Il y a des femmes qui rencontrent ou croisent leurs violeurs. Je reçois de nombreux témoignages depuis la sortie du livre. Quelqu’un m’a dit que l’on a interdit à son cousin militaire de regarder d’une manière méchante le terroriste qui a assassiné ses camarades. Dans les années 1990, les terroristes étaient des barbares sanguinaires, des hordes sauvages. Avec la réconciliation, ils sont devenus des égarés, des repentis, puis des gens respectables dont il ne faut pas parler sous peine de poursuites.
Les peuples et les individus se construisent et se reconstruisent sur un sentiment de justice. Comment voudrions-nous transmettre des valeurs à nos enfants dans un pays où un voleur de téléphone risque trois ans de prison et un terroriste qui a égorgé des femmes et des enfants se promène au soleil ?
Votre livre ne sera pas édité en Algérie. Pourquoi ?
L’éditeur qui a été contacté a refusé de le publier. Il risque de tomber sous le coup de cette loi de 2005, que je mets en exergue dans le livre. Elle existe depuis vingt ans, mais on peut la ressortir à tout moment. C’est une épée de Damoclès. En 2014, pour les besoins de la réélection de Bouteflika à un quatrième mandat, la télévision d’État a diffusé des images insoutenables des massacres pour terroriser les électeurs. Le pouvoir avait enfreint ses propres lois pour faire réélire un président fantôme. Le message était : vous avez le choix entre Bouteflika et un retour à la décennie noire. On a placé cette décennie sous une chape de plomb, mais on l’instrumentalise à des fins politiciennes au besoin.
Vous vivez en France depuis an. Pourquoi avez-vous quitté l’Algérie ?
Je n’aime pas faire étalage des raisons de mon départ. J’avais envie d’une nouvelle vie. En Algérie, je tournais en rond. L’écriture de chaque phrase me pesait. J’avais besoin d’oxygène. En France, je jouis de toutes les libertés d’écrire des romans et des essais sans devoir me battre contre mille et un procureurs. Ce qui m’a tué, en Algérie, c’est la misère intellectuelle. Un écrivain y passe plus de temps à se justifier qu’à faire son métier.
Quel regard portez-vous sur l’Algérie d’aujourd’hui alors que le président Tebboune entame un second mandat?
L’Algérie me fait mal, comme à beaucoup d’Algériens. Tu as mal quand tu y habites, tu as mal quand tu la quittes. Les gens ne comprennent pas mon patriotisme. Ils veulent que je sois nationaliste, je ne le suis pas. Je suis patriote, mais pas nationaliste. Cet hypernationalisme, cette vanité, ce narcissisme, je ne les ai pas. Souvent, on définit l’algérianité comme si elle devait être antifrançaise : on est Algérien parce qu’on est antifrançais. J’adore l’Algérie et j’adore la France.
La tragédie de l’Algérie aujourd’hui, je la vois plus à l’école qu’au siège de la présidence. Les Islamistes contrôlent l’école. C’est là le drame de ce pays. Il y a deux images qui m’ont traumatisé. Celle de l’assassinat du président Boudiaf, en juin 1992 et celle d’Abdelkader Bengrina faisant du toboggan dans un jardin public pour faire campagne pour la réélection du président Tebboune.
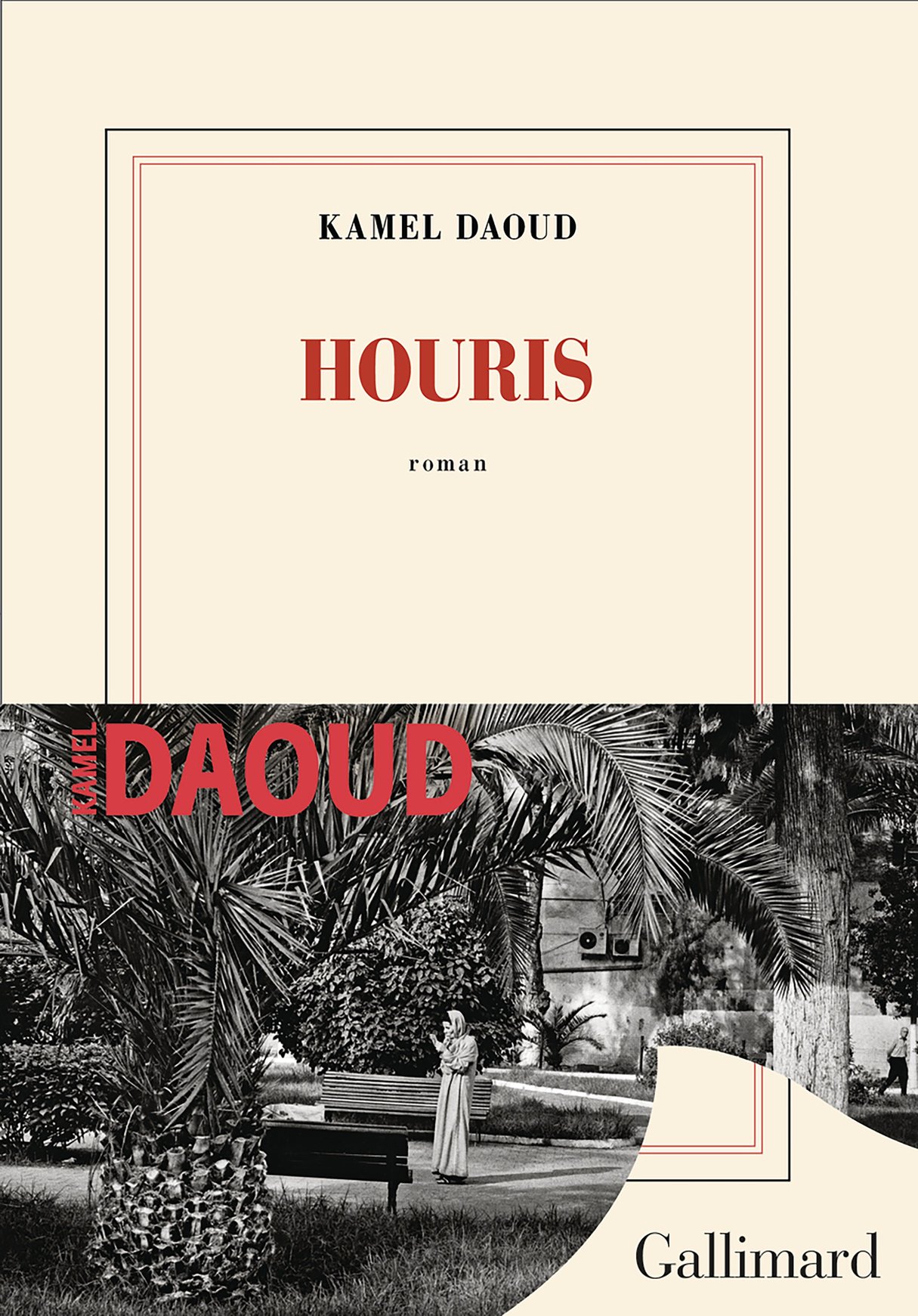
Houris, de Kamel Daoud, éd. Gallimard, 416 pages, 23 euros