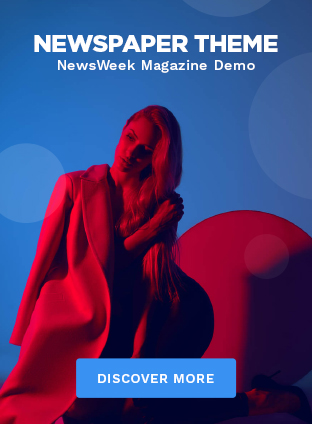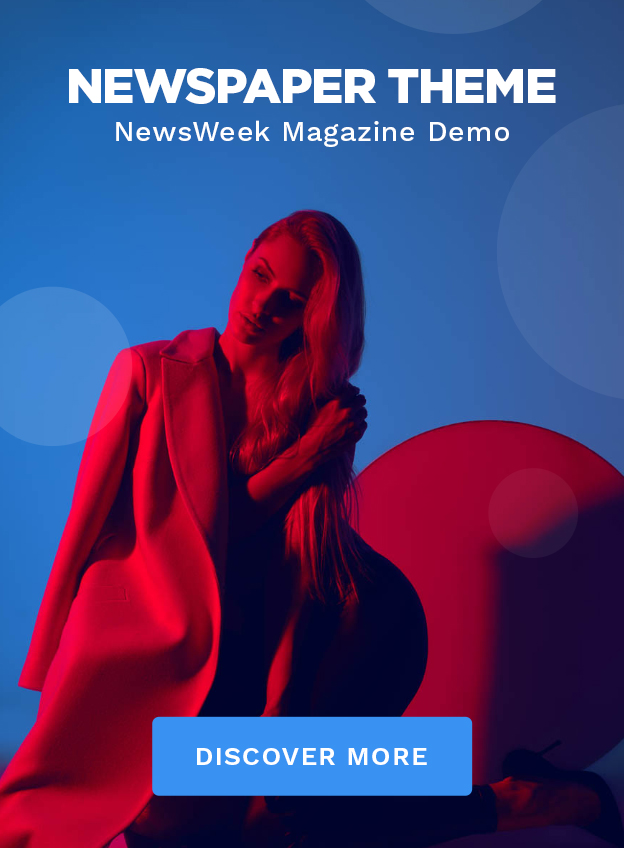De la musique avant toute chose. Plus qu’un art poétique, ce fut, pour Myriam Mihindou, une nécessité. Invitée par le Musée du quai Branly-Jacques Chirac, à Paris, l’artiste a souhaité en premier lieu occuper l’espace par le son. « Parfois, la vibration est plus importante que l’objet », confie-t-elle dans un sourire.
Pleureuses punu
Ses pas la conduisent dans la verrière, qui abrite les collections d’instruments de musique du musée. Des réserves d’une richesse exceptionnelle, mais inexplicablement muettes. Son choix se porte sur des harpes sacrées du Gabon. Les plus anciennes sont surmontées de têtes zoomorphes, les plus récentes de figures féminines. L’artiste décide de reproduire en céramique ces harpes, qui accompagnent les initiations, et place ces œuvres à l’entrée de l’exposition. Le décor est planté. Ce sera un hommage aux pleureuses punu.
L’exposition Ilimb l’essence des pleurs, présentée du 6 février au 10 novembre 2024, est un retour aux sources pour Myriam Mihindou, née en 1964 à Libreville d’une mère Française et d’un père Gabonais de culture punu, peuple bantou présent notamment dans le sud du pays.
« Si j’avais vécu au village, j’aurais été pleureuse », admet l’artiste, qui a souhaité remercier ces femmes qui l’ont aidée à porter le deuil de son père. Au centre d’une société matriarcale, ces veuves assurent le transport de l’âme du défunt et consolent les personnes endeuillées dans une ritualisation subtile. « La gestion des larmes exige des pleureuses une connaissance scientifique, généalogique, historique, intime et spirituelle, souligne Myriam Mihindou. Elles sont l’un des derniers maillons d’un héritage ancestral. » Un patrimoine immatériel en péril, qu’il est nécessaire de transmettre.
Ciel gabonais
Pour mettre les visiteurs en contact avec cette culture d’accompagnement des morts, mystique et cathartique, l’exposition se doit d’être immersive. « Il a fallu mettre en place un dispositif qui consiste à convoquer les pleurs de ces femmes dans un champ vibratoire », confirme la plasticienne. Ainsi, l’œuvre qui structure l’espace de l’exposition, une sculpture végétale, véritable ligne de vie tressée avec du bois de saule qui ondule sur une vingtaine de mètres, se veut à la fois tactile et sonore. Quand on la caresse, un système de détection magnétique pensé par le concepteur acousticien Didier Blanchard produit des sons, des bruits de percussions ou bien ce roulement de tonnerre qui gronde quand le ciel gabonais s’ennuage et se fait menaçant.
Plus loin, devant une sculpture en bois représentant la main d’une pleureuse, on écoute un enregistrement d’Annie-Flore Batchiellilys, qui, de sa voix lustrale et magnifique, chante a cappella une complainte composée pour l’occasion.
Myriam Mihindou multiplie les moyens d’expression plastiques. Céramiques, sculptures, vanneries, dessins aux lignes épurées ou brisées, figure de cheval construite en filant des pièces de monnaie dans des tiges en cuivre, poteries en sel, argile et kaolin blanc émaillent le parcours. Une constante dans son œuvre, à travers laquelle elle souhaite avant tout extérioriser ses émotions. Et si le dessin reste la pierre angulaire de son travail de recherche, le déclic a peut-être été la photographie.

La plasticienne gabonaise Myriam Mihindou, au Musée du quai Branly, à Paris, en 2024. © Photo Thibaut Chapotot
« Mon pays dans une flaque »
Encore adolescente, Myriam Mihindou révèle des films dans le laboratoire de Jean Trolez, un photographe français alors installé à Libreville, qui réalise des cartes postales dans tout le territoire gabonais. « J’ai découvert mon pays dans une flaque », s’amuse-t-elle. Alors que le photographe se rend dans de nombreux villages à l’intérieur des terres, leurs images se dessinent dans les cuves de développement des films. « Je n’arrivais jamais à me décider à fixer les films. Fixer l’image, c’est une mélancolie. Quand on révèle une image, c’est un paysage. Il est ouvert, mouvant. Il est vivant et il ondoie. Quand on le fixe c’est un fossile, c’est la mort », se souvient-elle. La suite de sa vie sera un long voyage.
La marche est une pensée. Je me perds, mais je retrouve toujours mon chemin.
la suite après cette publicité
Diplômée de l’École supérieure des Beaux-arts de Bordeaux, l’artiste passe ensuite plusieurs années sur l’île de la Réunion, au Maroc et en Égypte, un pays qui la fascine. « Ce qui m’a marquée en Égypte, c’est l’atemporalité. Dans la journée, il est impossible de savoir quelle heure il est. Le ciel est blanc, le paysage est blanc. Au quotidien, les mouvements sont lents. C’est le pays d’outre-tombe, le pays des morts et non des vivants, mais on y vit joyeusement. » La dimension mystique de la culture égyptienne devient une source d’inspiration alors que sa rencontre avec l’archéologue Jean-Yves Empereur lui permet de se rendre, à Alexandrie, « dans des lieux inaccessibles, où l’on ressent les strates de l’Histoire ».
Suivront d’autres séjours plus ponctuels au Vietnam, au Burkina Faso, au Rwanda et au Mali, souvent dans le cadre de résidences artistiques, qui sont l’occasion pour la plasticienne d’élargir ses recherches culturelles, en particulier dans le domaine des arts sacrés africains. Son expertise en la matière lui a valu d’intégrer le conseil d’administration de la Fondation Dapper, en 2007, après une exposition personnelle organisée au sein du musée parisien de l’institution – fermé depuis.
Haïti et le vévé
Bourlingueuse, Myriam Mihindou est également une infatigable marcheuse. « La marche est une pensée. Je me perds, mais je retrouve toujours mon chemin. Cette marche m’intéresse parce que les villes mentent, soutient l’artiste. Elles offrent des vitrines trompeuses devant lesquelles il ne faut pas s’attarder. » Sortir des ornières et découvrir de l’authenticité à tout prix. Présente en Haïti peu après le renversement du président Aristide, en 2004, elle s’échappe, au mépris du danger, « par toutes les portes » de la résidence protégée dans laquelle elle est confinée.
Elle visite tous les quartiers de Port-au-Prince, s’initie au vévé, marraine une troupe de théâtre et tente de communiquer « avec ce corps qui a été déporté », de « comprendre la tragédie de l’histoire caribéenne, qui mêle une violence extrême et inouïe à une beauté inqualifiable ». De ces escapades ressortira une série de photographies tirées en négatif et intitulée Déchoucaj’, qui sera présentée plus tard à la Biennale de Dakar pour renouer le dialogue entre les cultures africaines et caribéennes.
On retrouve en filigrane, dans cette œuvre, le thème principal de Myriam Mihindou, ce corps blessé, mutilé, dominé qu’il faut soigner et libérer. L’expression de l’artiste atteint son paroxysme lors de performances, véritables transes pendant lesquelles elle entre en communion avec les spectateurs.
« La performance vient exprimer un récit qui te traverse. Tu es en le vecteur et le porteur de parole. On a la sensation d’être sur un autre parallèle et de tout voir à la loupe. C’est une expérience collective dans laquelle on va chercher une émancipation personnelle. C’est un moment d’extrême liberté et d’indocilité », décrit-elle. La portée curative et rituelle de ces performances n’est pas sans rappeler les pleureuses punu. En 2004 déjà, elle rendait hommage à sa sœur, « partie trop tôt », avec la Colonne vide, « performée » sur la place des Invalides, à Paris.
Métonymie du corps par excellence, le thème de la main revient de façon obsessionnelle dans sa production artistique. La série de photographies Sculptures de chair, où l’artiste vient déposer sa main en offrande aux premières lueurs de l’aube, est « l’une de ces citadelles qui tiennent et resserrent les mailles de l’ensemble du corps de [s]on travail ».
Les visiteurs de la Biennale de Lyon ont également pu découvrir, le 21 septembre dernier, « Lève le doigt quand tu parles », œuvre monumentale qui présente des moulages de bras de femmes avec l’index levé (tour de force technique pour de la sculpture en ronde-bosse !), qui ouvre l’espace d’exposition. Car, pour Myriam Mihindou, les projets se multiplient, en cette fin d’année. Alors que l’exposition du Musée du quai Branly ferme bientôt ses portes, l’artiste revient de la Biennale de Gwangju, en Corée du Sud, pour inaugurer sa rétrospective intitulée Praesentia, au Palais de Tokyo, à Paris. « Reprenant la ligne tendue de plusieurs années de travail », elle se tiendra du 17 octobre 2024 au 1er janvier 2025.

Expositions de Myriam Mihindou à Paris : au Musée du quai Branly (jusqu’au 10 novembre 2024), au Palais de Tokyo (jusqu’au 1er janvier 2025). © Palais de Tokyo, Musée du quai Branly