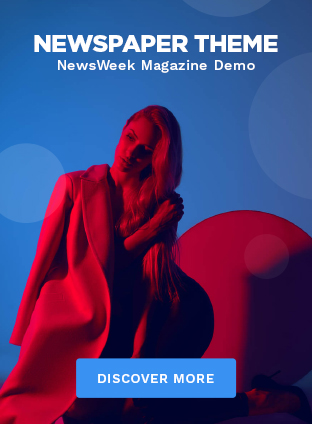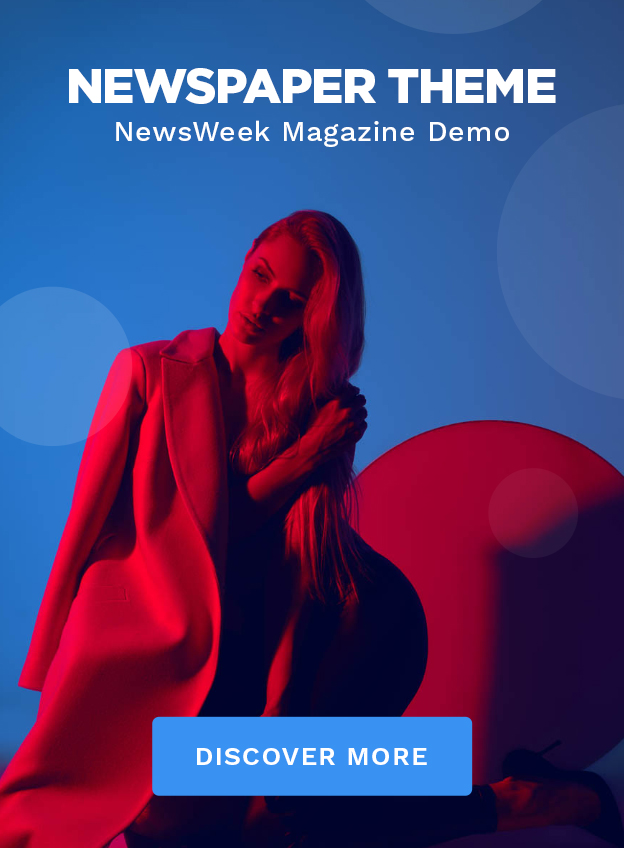Lorsque Les Carnets d’El-Razi est publié en version arabe en 2017 avec une première parution au Liban, son auteur, Aymen Daboussi, est victime d’une pétition à son encontre au sein de l’hôpital psychiatrique d’El-Razi, dans la banlieue de Tunis, où il a exercé pendant six ans. Son expérience de psychologue dans cette structure de santé publique au nord-ouest de la capitale lui a inspiré en grande partie les faits racontés de manière fictionnelle dans son roman. « À mi-chemin entre le documentaire, l’autobiographie et la fiction », résume le psychologue, qui a finalement démissionné pour partir exercer dans le privé.
« Le livre a été mal reçu, c’est le moins qu’on puisse dire, et c’est dommage car il n’y a pas eu de débat ni même de médiatisation autour de ce qu’il dénonce : la violence d’une machine institutionnelle où la folie est devenu un marché rentier », explique l’auteur. Sa traduction française, publiée en 2023, a pourtant trouvé un écho auprès de lecteurs qui se sont reconnus dans « ce miroir déformé de la société tunisienne », ajoute Aymen Daboussi.
Alors qu’après la pandémie, la question de la santé mentale s’est introduite dans le débat en Tunisie, comme dans le reste du monde, le rapport à la folie et aux troubles psychiatriques reste tabou, malgré l’augmentation des troubles anxio-dépressifs constatés par les psychiatres.
Un portrait au vitriol
L’hôpital El-Razi, du nom d’un savant persan du Xᵉ siècle, a accueilli ses premiers malades en 1931. Aujourd’hui, malgré son côté novateur et ses traitements de pointe de la maladie d’Alzheimer et d’autres pathologies neurologiques, il est toujours perçu dans l’imaginaire collectif comme le lieu des marginaux et des rejetés par la société. Seule structure uniquement consacrée à la santé mentale dans le pays, l’hôpital est souvent surchargé par l’afflux des demandes de consultation.
Dans le carnet de bord de son quotidien à l’hôpital, le narrateur décrit surtout une société à vau-l’eau où les patients imaginaires, attendrissants pour la plupart, sont difficiles à soigner. Face à son impuissance, le narrateur sombre lui-même progressivement dans la folie, hallucine et discute avec des incarnations de ses écrivains favoris, de Dostoïevski à Bukowski en passant par le poète Al-Maari et Dante. Dans de courtes séquences se déroulant dans le cabinet d’un psychologue, il distille aussi un portrait au vitriol du système de santé tunisien : la violence cynique des infirmiers, qui ne peuvent plus gérer certains patients agressifs, le lobby médico-pharmaceutique face à l’arrivée de « médicaments révolutionnaires », qui ne sont qu’en fait que des psychotropes addictifs.

L’hôpital El-Razi, à Tunis. © DR
« C’est un livre que je n’aurai certainement pas pu écrire avant la révolution », explique Aymen Daboussi, qui en a commencé la rédaction en 2013. « J’ai voulu à la fois profiter de la nouvelle liberté d’expression que l’on avait acquise, et en même temps montrer comment les aspirations à la liberté réclamées avec la révolution nous étaient aussi progressivement retirées » ajoute l’écrivain.
Repli religieux et chaos politique
Au moment où il écrit, le pays vit une crise politique sans précédent, avec deux assassinats politiques et la mise au ban des islamistes, majoritaires au pouvoir à l’époque. La révolution n’est plus perçue comme un soulèvement salutaire après des années de dictature mais au contraire comme le déclencheur de tous les maux que vit le pays : crise socio-économique, débat identitaire, peur d’un repli religieux et chaos politique.
Dans cette phase de la Tunisie post-révolution, le psychologue voit défiler des patients atteints de différents maux : une jeune fille victime d’un viol en réunion, dont le père réclame des documents attestant de son traumatisme pour le tribunal mais sans accepter qu’elle bénéficie d’un soutien psychologique, un jeune qui porte sans cesse des lunettes noires même pour dormir, un adorateur du « dieu fécal » que le chef de service n’a pas d’autre choix que de laisser partir après moult épisodes impliquant des excréments.
la suite après cette publicité
Le social et l’humain atténuent la violence et le désespoir des récits. Dès le début du livre, lorsqu’il plante son décor, le narrateur l’affirme : « Ici, il n’y a pas de fous, c’est la dernière chose qu’on s’attendrait à y trouver. Personnellement j’en ai rencontré très peu. Par contre, on y trouve beaucoup de miséreux. » C’est ainsi qu’un agriculteur se retrouve accusé de folie après avoir creusé des dizaines de tombes dans son champ : victime d’une terre infertile à cause du réchauffement climatique, il voulait la convertir en cimetière et « investir dans la mort ».
Déconstruire les tabous
Ses portraits humanistes et attachants racontent surtout un rejet social et une incapacité à trouver du soutien dans une structure de soins adaptée. « Ce que j’ai ressenti ce matin, et qui m’a fait pleurer, c’est ce sentiment terrible d’être concerné par les rêves des autres humains et par leurs souffrances, où qu’ils soient », lance, désemparé, le narrateur. Celui qui rêvait d’être un réformateur à la façon de Kheireddine Pacha – un homme politique tunisien du XIXᵉ siècle connu pour ses réformes en matière d’éducation et d’organisation administrative – se retrouve à souhaiter devenir lui-même fou. « J’étais un peu naïf lorsque j’ai commencé à Razi, je pensais que j’allais changer les choses, ensuite je me suis retrouvé à n’être qu’un psychologue testeur, condamné à faire des bilans de personnalités », commente Aymen Daboussi.
Le livre, cathartique, lui permet de faire le bilan de ses années sur place « mais aussi d’essayer d’interroger le lecteur sur nos maux en tant que société ». À travers l’histoire de ses patients, l’auteur déconstruit certains sujets tabous : le rapport à la religion, aux symboles nationaux, et les nombreux préjugés sur la folie. « L’idée était aussi de montrer que dans le contexte de crise que nous vivons, le sacré n’était plus vraiment un référent pour gérer les communautés d’hommes dans cette fiction où tous les personnages sont en manque de repères », explique Aymen Daboussi, qui garde jusqu’au bout du livre un humour désopilant, seul ressort pour nuancer le tragique de ses chroniques, encore très actuelles.

© Éditions Philippe Rey
Les Carnets d’El-Razi, d’Aymen Daboussi, traduit par Lotfi Nia, éd. Philippe Rey, 324 pages, 20 euros.