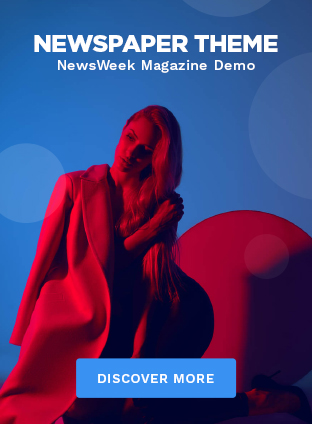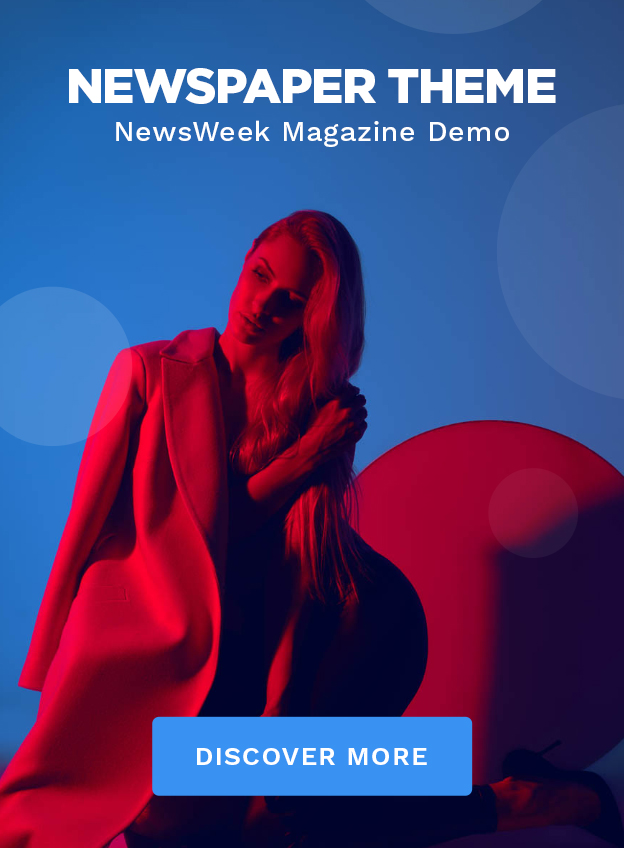Si c’était à refaire, il commencerait par là : écrire dans sa langue maternelle. Ainsi se conclut notre conversation avec Boubacar Boris Diop. Le romancier et essayiste sénégalais, né en 1946 à Dakar, a attendu 2003 avant de publier son premier roman en wolof, Doomi Golo (Papyrus, Dakar), traduit en français par ses soins six ans plus tard (Les Petits de la guenon, éd. Philippe Rey). Depuis, l’auteur a choisi d’écrire son œuvre de fiction uniquement en wolof.
La question de la langue est au centre de l’œuvre de l’ex-journaliste qui, depuis sa politique-fiction Le Temps de Tamango (L’Harmattan, 1981), interroge la mémoire du Sénégal, à travers sa littérature, ses mythes et son actualité. Dans Un tombeau pour Kinne Gaajo, son nouveau roman, une écrivaine fictive meurt dans le naufrage du ferry Joola, en 2002.
Comme souvent chez Boubacar Boris Diop, on y croise des « cinglés », une femme forte et énigmatique, des politiciens frappés du complexe du sauveur, d’appétissants plats sénégalais (baasi-salte, ñeleñ, ndambe et mbaxalu-saalum), des expressions en wolof et une cartographie de Dakar, « ville-pagaille » ; ainsi que les proverbes du « malicieux et quasi imparable » Njaajaann Njaay, le mythique ancêtre fondateur de la nation wolof.
Quatre « mots de passe » pour arpenter une œuvre prolifique, récompensée en 2022 par le prestigieux prix international de littérature Neustadt.
« Léebóon »
« Léebóon », « il était une fois » en wolof, résonne dans la plupart des romans que Boubacar Boris Diop situe au Sénégal, prononcé par le narrateur ou des personnages secondaires. « Une histoire ne vaut que racontée par la langue de qui l’a vécue », dit un proverbe sénégalais, repris de livre en livre. Souvent, la personne à qui est adressé le conte intervient, et les histoires s’enchâssent. Un tombeau pour Kinne Gaajoo ne déroge pas à la règle.
Le roman est divisé en deux grands récits – celui de Njéeme Pay, qui tente une biographie de son amie Kinne, puis celui de cette écrivaine et prostituée. L’omniprésence de la fable chez Boubacar Boris Diop reflète son « panthéon littéraire », dominé par une conteuse en wolof : sa mère. « J’étais un enfant impressionnable et donc persuadé que tout ce qu’elle disait était vrai, se souvient-il. J’ai très tôt compris la puissance des mots – proférés ou imprimés –, mais aussi que le monde réel et le monde imaginaire peuvent n’en faire qu’un. »
Les auteurs français du XIXe siècle, mythifiés par son père, un intendant né « la même année que Léopold Sédar Senghor [1906-2001] », ont également influencé l’écrivain. Dans un premier roman jamais publié, écrit à 15 ans, résonnait « un lyrisme extraordinaire » issu de Lamartine ou de Rimbaud. « Je n’avais pas d’intérêt pour ce qui se passait dans la société, juge-t-il. Quand je faisais de belles phrases, j’étais content. Puis, j’ai compris que ce n’était pas de la littérature. »
Il vous reste 71.57% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.