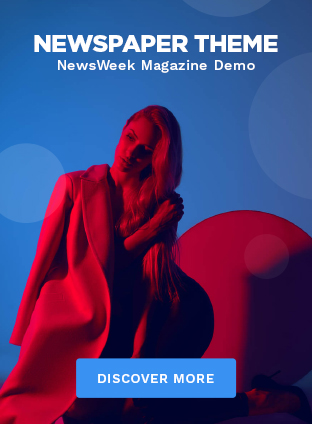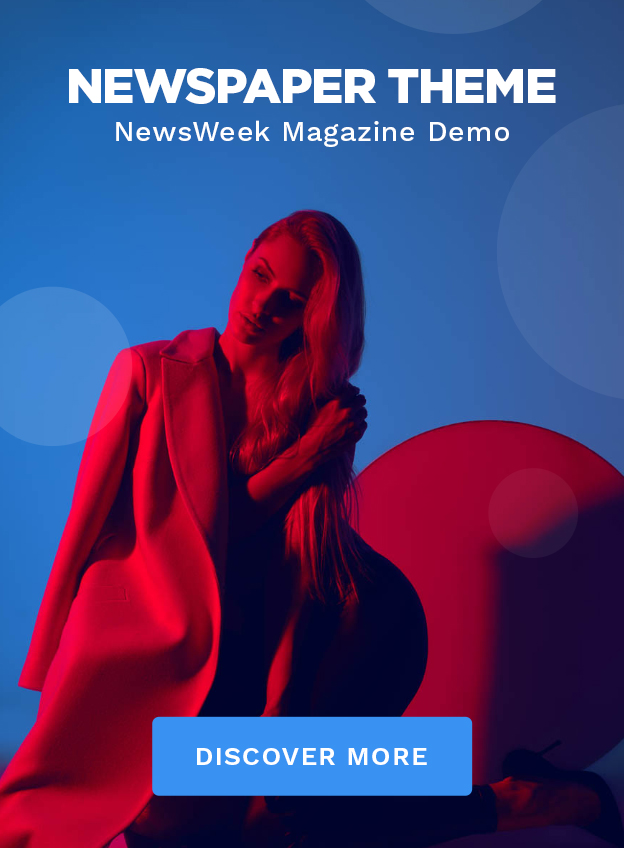L’économiste et ancien ministre togolais Kako Nubukpo, connu pour sa critique du franc CFA, poursuit au fil de ses ouvrages sa réflexion sur le développement de l’Afrique. Dans L’Afrique et le Reste du monde. De la dépendance à la souveraineté (Odile Jacob, 208 pages, 21,90 euros), paru en octobre, il invite à prendre la mesure de la montée en puissance de la jeunesse. Non seulement pour ses répercussions sur la gouvernance du continent, mais aussi pour le reste du monde.
Il n’est plus possible, dites-vous, de comprendre ce qui se passe en Afrique sans prendre en compte le poids de la jeunesse. Pourquoi ?
C’est le point de départ de ce livre : la succession d’alternances non démocratiques en Afrique de l’Ouest au cours des dernières années m’a amené à m’interroger sur l’évolution de la gouvernance politique en Afrique. La volonté de contenir la menace djihadiste – mieux que ne l’avaient fait jusqu’alors les présidents civils – a motivé la prise du pouvoir par des militaires, plus conscients – car en première ligne – de la gravité de la situation sur terrain.
Mais il y a aussi une question générationnelle, dont témoigne l’adhésion de la jeunesse. Ces jeunes militaires, avec le pouvoir des armes, offrent à ces jeunes une forme de revanche par procuration sur des régimes qui ne se sont pas préoccupés de leur avenir. Soixante ans après les indépendances, ces événements sanctionnent l’échec des élites urbaines, dont je fais partie, à créer de la prospérité.
Que voulez-vous dire lorsque vous parlez d’une déflagration à venir ?
A la faculté des sciences économiques et de gestion de Lomé, où j’enseigne, nous sommes 20 professeurs pour 20 000 étudiants. Nous savons qu’il ne nous est pas possible de bien les former. Mais ces étudiants sortiront pourtant de l’université avec un diplôme et ils iront grossir le flot des chômeurs urbains avec beaucoup de rancœur, car faire des études a fait naître chez eux d’autres attentes. Il existe des exemples comme celui-ci partout en Afrique.
La population africaine va doubler d’ici à 2050. Il s’agit d’un bouleversement considérable. Cette réalité va faire chuter tous les régimes que l’on dit forts et qui sont en réalité extrêmement fragiles du fait de ce poids croissant de la jeunesse. Car en face, il n’y a rien : pas d’emplois, pas de perspective, pas de discours politique mobilisateur autre que le discours anti-Occident qui prospère au Sahel. Comment ces espaces ne pourraient-ils pas finir par imploser ?
C’est le moment choisi par les Européens pour se désengager en réduisant leurs budgets d’aide au développement…
Il y a certainement une analyse critique à faire de l’aide étrangère pour parvenir à un meilleur ciblage, mais réduire les budgets de 35 %, comme ce qui est en train d’être adopté dans le budget 2025 de la France, c’est aller à contre-courant de l’histoire. L’Europe dépense des milliards d’euros pour bloquer l’immigration au lieu de les investir dans le développement. On marche sur la tête, on ne met pas l’argent là où il aurait un impact à long terme.
La France s’est elle aussi réfugiée dans un discours de repli. C’est une erreur. La relation de la France et de l’Afrique reste, qu’on le veuille ou non, singulière. Elle ne peut pas devenir par un coup de baguette magique une relation Europe-Afrique. Il faut assumer ce passé, mais j’ai le sentiment que les dirigeants français n’ont pas fait la prospective de l’Afrique. Ils n’ont pas défini la place que devrait occuper le continent dans une vision de long terme.
Vous opposez au libre-échange général la nécessité pour l’Afrique de mettre en place un « protectionnisme écologique ». Qu’est-ce que cela signifie ?
Je suis attaché au multilatéralisme, mais je défends pour l’Afrique un juste échange, un protectionnisme écologique, parce que j’estime que les néolibéraux ne sont pas intellectuellement honnêtes.
Restez informés
Suivez-nous sur WhatsApp
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
Le système néolibéral qui a été imposé à l’Afrique repose sur deux principes de base. Le premier est la flexibilité des prix grâce à la concurrence, or les économies africaines sont dominées par des monopoles qui maintiennent des prix supérieurs à ceux attendus d’une concurrence pure et parfaite. Le deuxième principe est celui de la mobilité des facteurs de production : capital et travail. Le capital fait plusieurs fois le tour de la planète en une journée, mais le travail est bloqué par les visas.
En conséquence, il faut protéger les marchés pour que les jeunes Africains puissent rester vivre en Afrique et transformer localement les matières premières. Nous savons que c’est la seule façon de créer de la richesse et de l’emploi.
N’est-ce pas ce qui est en jeu à travers l’exploitation des minerais nécessaires à la transition énergétique ?
Je ne vois malheureusement rien de positif. Nous repartons dans le pillage de l’Afrique, avec des formes d’extractivisme justifiées par les besoins de la transition énergétique et numérique. Les enjeux d’accès à ces ressources sont tellement cruciaux au niveau mondial que je ne crois pas qu’il soit donné à l’Afrique le temps de transformer ses matières premières. Regardez par exemple la compétition féroce à laquelle se livrent les Américains et les Chinois en République démocratique du Congo.
L’histoire est donc condamnée à se répéter ?
L’Afrique doit définir sa propre voie. Je ne pense pas qu’elle se retrouve dans un néolibéralisme finissant prodigué par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ou dans un panafricanisme de repli qui consiste à prendre la France comme un ennemi.
Je plaide pour une troisième voie, qui est celle portée par la « théorie des communs » et qui a toute sa place dans le contexte de double défaillance du continent : celle des Etats et celle du marché. Cette idée avancée par l’économiste américaine Elinor Ostrom met en avant le principe d’auto-organisation à partir des territoires et des communautés. Beaucoup de solutions aux problèmes que connaît l’Afrique se trouvent dans des réponses locales.
Les Etats ne sont plus présents dans de larges portions de leurs territoires, comme au Burkina Faso, où plus de la moitié du pays échappe à l’Etat. Les plans d’ajustement structurel ont détruit l’embryon d’Etat social que les pays essayaient de construire sur l’agriculture, la santé, l’éducation. Toutes les expériences des vingt premières années des indépendances ont été balayées pour se concentrer sur les équilibres macroéconomiques. La capacité des Etats et des administrations à concevoir et à mettre en œuvre des politiques publiques est devenue très faible.
La théorie des communs propose sur le plan microéconomique un mode de production alternatif dans lequel la propriété privée n’est pas l’unique façon de gérer les actifs.
Cette proposition semble peu audible dans les débats actuels…
Je suis conscient d’être minoritaire. Il est pourtant des sujets très concrets pour lesquels il est possible de démontrer l’intérêt d’une approche fondée sur les communs. La gestion de la transhumance en est un. Au cours des 40 dernières années, le réchauffement climatique a fait chuter la productivité agricole de 20 % en Afrique de l’Ouest. Pour compenser cette perte, les paysans augmentent les superficies cultivables et réduisent les couloirs de transhumance. De leur côté, les populations nomades migrent vers le sud. Les conflits se multiplient autour de l’accès aux ressources naturelles. Les communs offrent un moyen de renégocier le contrat entre les différents groupes.
Cela peut paraître utopique, mais au moins peut-on reconnaître que ce qui a été essayé jusqu’à présent n’a pas marché. Il est donc temps d’essayer autre chose).