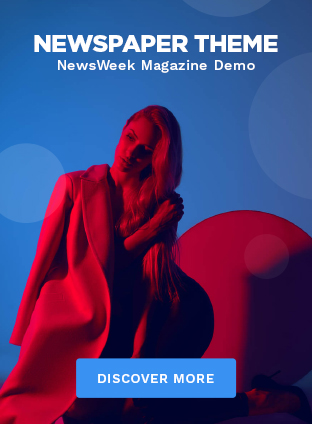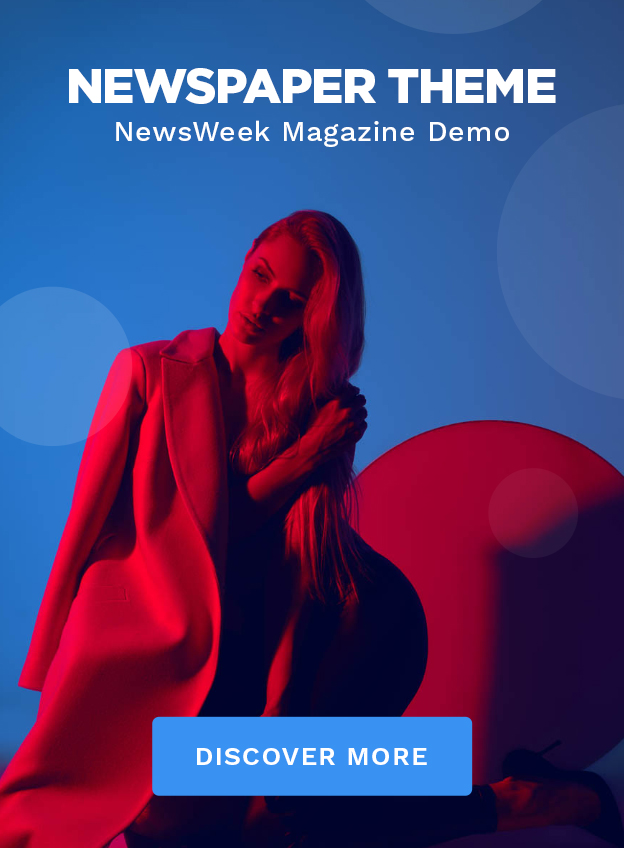Sur le tapis rouge du Festival de Cannes, en ce mois de mai 2018, Wanuri Kahiu est tout sourire. Son film Rafiki, contant l’histoire d’amour naissante entre deux jeunes femmes, est le premier long-métrage kényan à être sélectionné en compétition officielle. « C’est incroyable de monter le tapis rouge. C’est une première pour le Kenya et pour les femmes africaines. C’est une fierté pour le pays », déclare la cinéaste de 44 ans à l’un des nombreux journalistes présents.
Le film ne remporte pas de récompenses à Cannes cette année-là. Autorisé pendant seulement une semaine dans les salles kényanes en raison de son thème – l’homosexualité –, il connaît un beau succès international. Son actrice Samantha Mugastia remporte même la récompense de la meilleure actrice du Fespaco, le plus grand festival de cinéma africain, à Ouagadougou, en 2019.
Rafiki fait figure d’exception. Malgré ses 55 millions d’habitants, son rôle de leader économique dans la Corne de l’Afrique et un vivier certain d’auteurs, de réalisateurs et d’artistes, le Kenya peine à voir ses œuvres culturelles percer à l’étranger. Alors que le Nigeria et l’Afrique du Sud comptent des prix Nobel de littérature, des lauréats du Booker Prize et des films primés en festival, le Kenya ne rayonne pas autant.
« Nous n’avons pas une grande industrie ni une grande culture de cinéma même si elles existent tout de même », explique Sheba Hirst, la fondatrice du NBO Film Festival, installée à la terrasse du café Unseen, haut lieu du cinéma indépendant à Nairobi. Ce festival, dont l’édition 2024 se tient du 17 au 27 octobre dans la capitale, a notamment pour ambition de faire émerger un cinéma kényan vif et imaginatif alors que le pays ne compte que vingt-neuf salles.
« Nous manquons de scénaristes qualifiés »
Rarement plus de cinq longs-métrages sont produits chaque année, dont les budgets varient de 3 à 10 millions de shillings kényans (de 20 000 à 70 000 d’euros). « Le rôle d’un festival comme le nôtre est vital pour conserver la création. C’est presque une mission », explique la directrice du festival. Selon elle, si l’industrie cinématographique kényane peine à émerger, c’est qu’elle manque de bonnes histoires. « Nous avons une crise du storytelling. Les histoires proposées sont souvent trop liées à un thème et relèvent de la démonstration. Elles manquent de subtilité », note-t-elle.
Dans son bureau de l’université de Nairobi, Simon Otieno, professeur de cinéma, dresse le même constat : « Nous avons aujourd’hui de très bons techniciens, des caméramans, des monteurs, des cadreurs… Mais nous n’avons pas de bonnes histoires. Nous manquons de scénaristes qualifiés. »
Selon lui, le manque de bons narrateurs est étroitement lié à l’histoire politique du pays. « Depuis l’indépendance [en 1963], l’Etat ne comprend pas ce que sont le cinéma et le théâtre, poursuit-il. Les autorités n’y voient qu’un danger. Elles craignent qu’en voyant des spectacles, les gens prennent davantage conscience de leurs droits, qu’ils deviennent plus critiques. Il n’y a donc aucun intérêt, pour les politiques, à développer ce secteur. » « Il y a un anti-intellectualisme des gouvernements », abonde Sheba Hirst.
C’est ce qu’expliquait déjà Ngugi wa Thiong’o, le romancier kényan le plus lu dans le monde, dans son essai Décoloniser l’esprit (éd. La Fabrique, 2011) dans lequel il racontait la façon dont le président kényan Daniel arap Moi avait fait raser le théâtre de son village en 1982 en raison d’une pièce jugée subversive. « Le gouvernement (…) interdit toute activité théâtrale dans l’ensemble de la région. Un gouvernement prétendument “indépendant” du Kenya venait d’emboîter le pas à ses prédécesseurs coloniaux », y écrivait-il alors.
Le manque d’audace des éditeurs
Une loi illustre la méfiance des autorités à l’égard des œuvres de création : la loi « Cap 222 ». Celle-ci contraint les producteurs de cinéma à présenter à un organisme d’Etat, la Kenyan Film Classification Board (KFCB), les scénarios qu’ils veulent porter à l’écran. Si en cours de tournage, une ligne de dialogues doit être changée, le scénario doit obligatoirement repasser devant la KFCB. Une façon de tuer dans l’œuf la création. « Depuis des années, les réalisateurs demandent sans succès à ce que cette loi soit changée », explique Simon Otieno.
Pour pallier le manque de créativité, les organisateurs du NBO Film Festival ont eu l’idée de lancer en 2022 un concours de scénario avec une bourse d’écriture à la clé. Des scripts doctors étaient présents pour relire les textes. 1 200 personnes y ont concouru.
Les romanciers, eux, font face à un autre problème : le manque d’audace des éditeurs. « Editer des romans et en faire la promotion coûte cher. Les éditeurs traditionnels n’en prennent pas le risque, explique Tom Odhiambo, professeur de littérature à l’université de Nairobi. Ils préfèrent éditer des livres scolaires dont la lecture est obligatoire pour les élèves et dont ils savent qu’ils tireront des revenus certains. »
Suivez-nous sur WhatsApp
Restez informés
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
Conséquence, les aspirants romanciers se rabattent sur l’autoédition, très en vogue dans le pays. « Ils se font relire par une intelligence artificielle qui corrige la grammaire et impriment un exemplaire pour 300 shillings qu’ils chercheront à vendre 800. Le problème, c’est qu’une IA ne connaît rien en intrigue et dramaturgie. Les productions sont très variables. »
« L’effet “Black Panther” »
Le Kenya compte bien quelques plumes de renom comme Yvonne Adhiambo Owuor ou Binyavanga Wainaina (décédé en 2019). « Mais les médias ne s’y intéressent pas », constate Tom Odhiambo. « On a un bon nouveau roman tous les deux ou trois ans, quand les Nigérians en produisent cinq par an », estime Sheba Hirst.
Un rapport intitulé « Kenya Creative Economy Policy », paru en 2023, a établi la longue liste des difficultés auxquelles faisaient face artistes, créateurs et producteurs, tous secteurs confondus : frilosité des banques à accorder des prêts, cadre légal sur la propriété intellectuelle inexistant, lutte contre le piratage inefficace… Les auteurs soulignaient aussi le manque de studios, de scènes, de lieux d’exposition et de centres d’art à travers le pays.
A la terrasse du café Unseen, Sheba Hirst se veut pourtant confiante. Elle en veut pour preuve « l’effet Black Panther ». A sa sortie en 2018, le film a attiré dans les salles kényanes un nombre de spectateurs jamais vu jusqu’alors. Des gens qui ne se rendaient pas au cinéma. « Si on parvient à toucher ne serait-ce qu’un tout petit peu de ce public-là, le pari sera gagné », sourit-elle.