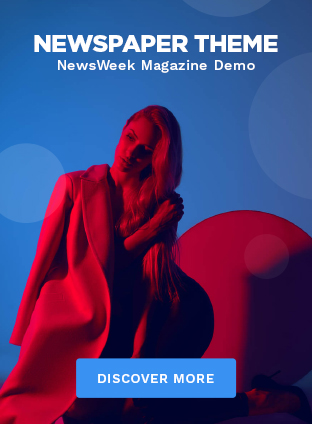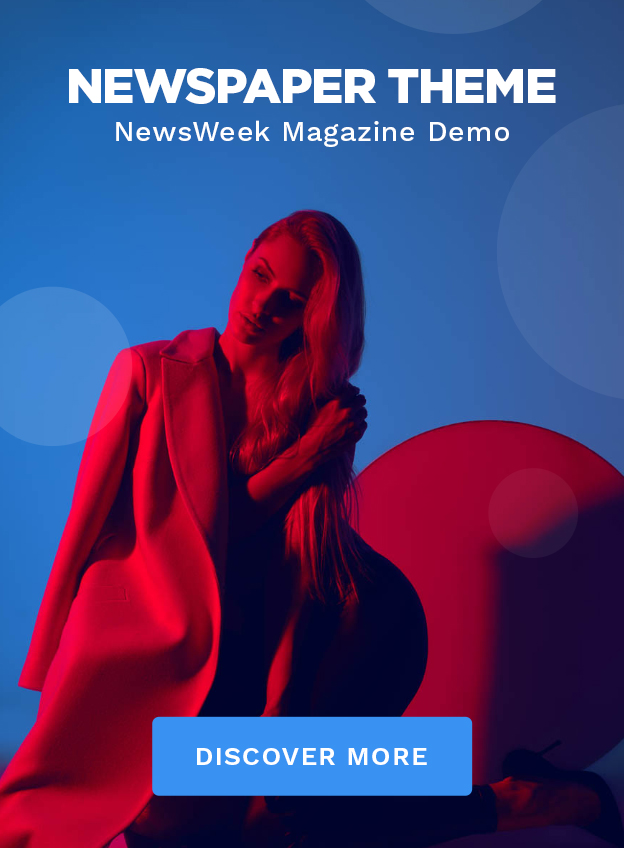C’est le premier procès du genre au Kenya. Douze femmes en colère, dont Mediatricks Khasandi, 34 ans, y dénoncent depuis plus d’un an un « trafic d’êtres humains » et des faits d’« esclavage moderne ». Comme des millions d’autres, elles ont été employées en tant que domestiques au Moyen-Orient, y ont été victimes d’abus physiques ou sexuels et s’estiment abandonnées par leur pays. Devant un tribunal de Nairobi, elles se dressent désormais face aux autorités kényanes, qui, selon les plaignantes, ne les ont ni informées, ni protégées des risques encourus.
Lorsque Mediatricks Khasandi atterrit à Tabouk, en Arabie saoudite, fin 2019, cette femme de ménage voit là une chance de quintupler son salaire. « J’étais en confiance, j’avais même un document signé et tamponné par le gouvernement kényan, qu’on appelle un contrat de service étranger », dit-elle. Son expérience tourne rapidement au cauchemar. Seule domestique pour une famille de 17 personnes, elle travaille jusqu’à vingt heures par jour. Son passeport lui est confisqué et son employeur la menace d’un couteau le jour où, malade, elle demande à être emmenée à l’hôpital.
Et lorsqu’elle se tourne vers les services consulaires de son pays pour solliciter un rapatriement ? « Le responsable de l’ambassade m’a insultée au téléphone, il m’a dit que les femmes stupides comme moi devaient retourner au travail, se taire et payer leurs dettes », se remémore-t-elle. L’échange téléphonique, que Mediatricks Khasandi a enregistré, est l’une des pièces à conviction du procès.
Les témoignages des autres plaignantes font tous état du refus systématique des autorités kényanes de leur porter assistance. La porte de l’ambassade à Riyad leur est restée fermée alors même que l’Arabie saoudite est un mouroir pour ces femmes : 183 Kényanes y sont mortes depuis 2021. Interpellé, le ministère kényan du travail se targue d’y avoir construit un abri d’urgence pour les femmes en situation de détresse. « C’est un mensonge, il n’y a ni refuge, ni maison sécurisée, ni protection… ni en Arabie saoudite, ni ailleurs au Moyen-Orient », affirme John Mwariri, l’avocat des plaignantes à Nairobi.
Réseaux de contrebande
Le Kenya, à l’instar d’autres nations africaines (Ethiopie, Sierra Leone, Burundi, Malawi), multiplie les accords bilatéraux de travail (ABT) avec les pays du Golfe. Ceux-ci visent à réglementer la mobilité d’une main-d’œuvre principalement composée de travailleuses domestiques. Elles sont plus de 6,6 millions au Moyen-Orient, venues principalement d’Asie et d’Afrique, selon l’Organisation internationale du travail (OIT). Les ABT doivent en théorie leur apporter une meilleure protection, alors que beaucoup rejoignent le Golfe via des réseaux de contrebande.
En octobre 2023, de retour d’une visite à Riyad, le président kényan, William Ruto, avait annoncé la création de 350 000 emplois dans le royaume pour ses concitoyens. « Les autorités saoudiennes disent que les Kényans travaillent plus dur que les autres ! », ne manquait-il pas de rappeler. Le chef de l’Etat projette d’exporter 5 000 travailleurs par semaine « pour qu’ils rapportent de l’argent », alors que l’Arabie saoudite représente la seconde source d’entrée de devises étrangères au Kenya.
Le Burundi s’est également mis d’accord en 2021 avec l’Arabie saoudite, puis en 2023 avec le Qatar, pour l’exportation de sa main-d’œuvre. Le ministère des affaires étrangères assure sur son site Internet que ce cadre institutionnel permet « une protection légale et sociale […] de la jeunesse, qui représente 60 % de la population ». L’Ethiopie a signé un accord similaire en avril 2023 avec Riyad pour l’accueil d’un demi-million d’employés. L’Arabie saoudite, comme les autres Etats de la région, n’a pourtant pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Dans les pays de départ, ces programmes sont gérés au sommet de l’Etat, qui les présente comme une façon de combattre le chômage mais aussi d’augmenter les entrées de devises étrangères. « Je ne vois pas en quoi envoyer nos filles en esclavage peut être considéré comme un progrès », rétorque l’Ethiopienne Banchi Yimer, qui fut employée comme domestique au Liban de 2011 à 2018.
A son retour, elle a créé une association, Egna Legna Besidet, qui combat la « kafala », un système qui fait des domestiques la propriété de leur « parrain » et les exclut des dispositions du droit du travail local. Très souvent, leur passeport est confisqué dès leur arrivée. « Tant que la kafala ne sera pas abolie, cela restera de l’esclavage moderne », dit Banchi Yimer. Comme elle, plusieurs associations de défense des droits humains accusent leur gouvernement de considérer l’exportation de leur force de travail comme une façon de développer un marché lucratif et peu réglementé, quitte à sacrifier les droits de leurs citoyens dans la péninsule Arabique.
Des victimes réduites au silence
Au Burundi, certaines agences de recrutement, dont l’agrément est délivré par l’Etat, sont accusées d’avoir abusé leurs clientes, notamment « en cas de rupture anticipée du contrat », raconte Espérance (son prénom a été changé).
Suivez-nous sur WhatsApp
Restez informés
Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »
Rejoindre
La jeune femme, rachitique, sort tout juste de l’hôpital. Avant de partir pour le royaume saoudien, en juillet 2023, elle pesait 69 kg ; elle en fait presque 30 de moins aujourd’hui. « A mon retour à Bujumbura, je ne tenais pas debout », dit-elle. Rapatriée pour raisons sanitaires avec le soutien financier de son employeur, elle n’a pas pu finir sa période d’essai de trois mois. Les agents qui l’avaient envoyée lui ont aussitôt réclamé le remboursement des « frais engagés », soit 12 millions de francs burundais (environ 3 800 euros).
Selon le rapport 2024 du département d’Etat américain sur le trafic de personnes, des « efforts » ont été faits par le Burundi pour se mettre en conformité avec les normes internationales. Mais la situation demeure préoccupante. D’après ce document, des agents continuent de toucher des commissions et des fonctionnaires restent impliqués dans ce trafic, notamment au commissariat général à la migration, une division du ministère de l’intérieur. Contactées par Le Monde, les autorités burundaises n’ont pas donné suite à nos demandes d’entretien.
Dans ce pays dirigé par le général et ex-rebelle Evariste Ndayishimiye, où 62 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, les victimes sont réduites au silence. « Certaines d’entre nous ont été jetées en prison », déplore Espérance. La justice ne s’est jamais saisie de ces abus et les conflits avec les 21 agences accréditées, selon un décompte du département d’Etat américain, sont réglés à l’amiable. D’autant que les recruteurs embauchent souvent des mères isolées.
« Le cadre légal au Burundi est à saluer, mais il y a toujours des problèmes comme la disponibilité tardive des visas, alors que les candidates ont contracté des dettes pour obtenir un passeport. Cela les fragilise et certaines doutent de l’efficacité de ceux qui les sélectionnent », estime Prime Mbarubukeye, le président de l’Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale (ONLCT).
Des Malawites en Israël
Au Kenya aussi, la fiabilité de certaines agences de recrutement est mise en cause. « Elles sont détenues par des hommes politiques, sont corrompues, et bénéficient de la complicité de l’Etat », accuse l’avocat John Mwariri, selon qui 35 % d’entre elles fonctionnent sans licence. « A peine les identifie-t-on qu’elles disparaissent, changeant de nom et d’adresse », indique-t-il, conscient de son incapacité à les traduire en justice. Pour l’Etat, « il s’agit avant tout d’une question d’argent », poursuit-il.
« Les gouvernements africains doivent absolument s’abstenir d’encourager leurs populations à émigrer dans le Golfe », plaide Ekaterina Sivolobova, directrice de l’organisation de défense des travailleurs Do Bold : « L’Ethiopie prend une part active dans le recrutement et la formation de domestiques vers l’Arabie saoudite. C’est irresponsable car les autorités éthiopiennes connaissent les conditions de travail et leur vulnérabilité dans le royaume. » De même, le nouvel ABT entre le Liban et l’Ethiopie, en 2023, ne comprend ni clauses de salaire minimum, ni mécanismes de lutte contre la confiscation de passeport – et donc la « kafala ».
Pis, le gouvernement éthiopien mobilise ses ressources au service de ces programmes, quitte à s’arranger parfois avec la vérité. Sur les réseaux sociaux, plus d’une centaine de comptes du gouvernement, des autorités régionales et du parti au pouvoir en font la promotion. Le budget de l’Etat est mis à disposition pour le recrutement, la formation et l’envoi d’un demi-million de domestiques en Arabie saoudite. En avril 2023, un message Facebook du ministère du travail prétendait avoir « éliminé le système de la kafala ». Un mensonge. Une autre annonce, émanant d’une région du sud de l’Ethiopie, promettait un salaire mensuel de 2 200 dollars alors que les domestiques touchent en réalité moins de 1 000 dollars par mois.
L’Arabie saoudite est loin d’être un cadre de travail apaisé pour les travailleurs éthiopiens. Depuis avril, 70 000 d’entre eux ont été rapatriés par leur gouvernement et les Nations unies. Un rapport de Human Rights Watch (HRW) de 2023 faisait état d’exécutions de centaines de migrants éthiopiens par les gardes-frontières saoudiens, évoquant de potentiels « crimes contre l’humanité ».
Plus récemment, le Malawi n’a pas hésité à mettre ses ressortissants physiquement en danger. Depuis novembre 2023, des centaines de Malawites ont été envoyés en Israël dans le cadre d’un programme gouvernemental d’expatriation de main-d’œuvre, pour travailler dans des fermes abandonnées par les employés agricoles depuis le conflit à Gaza. Douze d’entre eux ont été expulsés par l’Etat hébreu, début mai, pour avoir déserté les vergers israéliens.