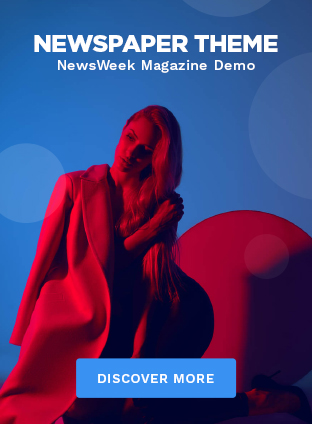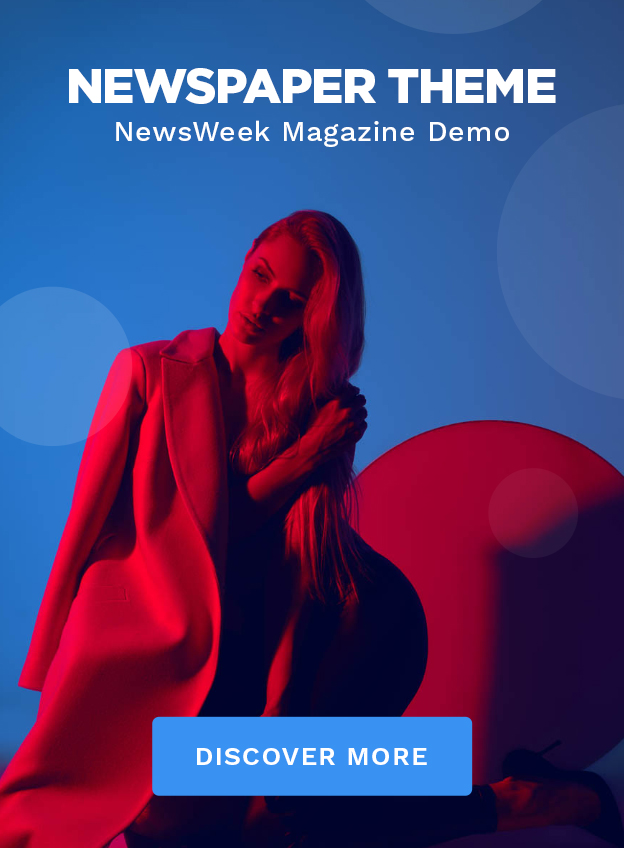Au départ, beaucoup l’ont pris pour un fou. Après une première expérience sur le toit d’un immeuble, Philippe Zerr s’est mis en tête, en 2020, de faire pousser radis et salades sur un bout de terrain mis à disposition par Grand Lyon Habitat au pied d’une barre dans un quartier populaire du 8 e arrondissement. « J’ai beaucoup entendu dire que mon terrain était trop petit pour en vivre, que j’aurais des dégradations, des vols… Dans le maraîchage, on compte en moyenne 1 hectare pour 1 travailleur, et moi j’ai démarré sur 600 mètres carrés. » Quatre ans plus tard, Philippe Zerr ne regrette rien. C’est le manque de verdure autour de son domicile qui l’a poussé à plaquer son emploi dans l’audiovisuel. « Je me disais : si je trouve un modèle économique, je ferai des émules et les propriétaires seront ravis de proposer leurs terrains. »
Dans sa tête, cet écolo se disait aussi : « Si tout s’effondre, j’aurai appris un métier utile, qui permet de nourrir les gens. » En quatre saisons, il n’a connu aucune dégradation importante. « On a parfois des dégâts parce que des gamins sont allés chercher un ballon, et quelques petits larcins. Mais c’est rare. Ça améliore le cadre de vie, la vue depuis les immeubles… » Avec 50 000 euros de chiffre d’affaires par an, son associé et lui ne roulent pas sur l’or, mais la ferme s’agrandit. « On se fait un petit smic pour quarante à quarante-cinq heures de travail. C’est vivable : on peut continuer. »
Diversification
Parisien d’origine, Stéphane Vier a trouvé lui aussi, avec Le Bouc et la Treille, l’équilibre de vie qu’il cherchait : « Je suis un urbain. J’habite derrière le TNP, à Villeurbanne, mes enfants vont à l’école à pied… J’ai la même vie que ceux qui vont au bureau. » Sauf qu’il travaille à la vigne, dans les monts d’Or, avec les préoccupations de ceux qui dépendent des aléas de la nature. Le domaine fait partie des pionniers du bio et des circuits courts dans les coteaux-du-lyonnais, une appellation autrefois dépréciée qui a su se réinventer. Le domaine propose une quinzaine de vins, des classiques cuvées Hircus – en gamay pour les rouges (13,50 €) et en chardonnay pour les blancs (14,50 €) – à la plus récente cuvée de vin orange, en passant par Le Bouc à poil, sans sulfites (12,50 €).
Avec 9 hectares, la diversification est incontournable afin de valoriser une production qui s’écoule pour moitié au domaine et à 95 % dans l’agglomération. Mais le climat, avec ses épisodes de grêle, de gel et surtout de sécheresse, a mis à mal les finances. « On est équipés pour 220 hectolitres. L’année dernière, on a péniblement sorti 130 hectolitres. Notre dernière année pleine remonte à 2018… » confie l’un des trois associés, Timothée Béchonnet. Ils auraient aimé agrandir le cuvage, mais le permis de construire a été refusé, dans un secteur où chaque parcelle constructible se revend une fortune.
« Le plus compliqué, c’est l’effondrement du bio. En redoublant d’efforts, on atteint péniblement le smic », souligne Timothée Béchonnet, pas découragé pour autant. Pour développer ses revenus, le domaine compte sur sa nouvelle gamme de spiritueux. Archéologue de formation,Timothée est heureux que ses associés aient fixé volontairement assez bas la valeur des parts sociales : « Je n’avais pas d’expérience. Je suis monté dans un train qui marchait… Je n’aurais jamais pu accéder à ce statut-là dans un autre schéma. » Le fait d’être trois permet aussi de répartir le travail. Même si tous assurent d’importants horaires, ils parviennent à préserver un week-end sur trois.
Le rythme de travail était aussi un sujet pour les trois associés de La Boule d’or, à Curis-au-Mont-d’Or, un maraîchage qui a trouvé son modèle économique en s’appuyant sur les ventes à la ferme. « Ceux à qui on a racheté avaient le même âge que nous, mais ils étaient issus du milieu agricole. Pour eux, faire soixante-dix heures par semaine, voire plus, c’était normal. Nous ne voulions pas tout sacrifier au travail. Nous avons des vies de famille, des enfants qui arrivent… » explique Félix Martin, 32 ans. Le pari est relevé. Les trois associés se sont fixé un salaire qu’ils estiment convenable – 2 500 euros net par mois – et ont consacré les moyens supplémentaires à des investissements et à des recrutements. « Ils étaient deux, plus un salarié. Nous sommes trois associés, avec trois salariés. Doubler la force de travail permet d’avoir un volume horaire soutenable. En hiver, on est à trente-cinq heures et en été, à quarante-cinq », détaille Félix Martin.
Autonomie
La clé ? Une organisation optimisée à laquelle cet ingénieur consacre la moitié de son temps. « C’est un métier physique, on se laisse vite déborder si on n’a pas désherbé une parcelle à temps ou pas décelé une maladie… Il faut se donner du temps pour faire des plannings, suivre ce qui pousse, ce qui se vend. » C’est pourquoi ils ont arrêté les paniers Amap, chronophages à préparer. « On a perdu certains clients, on en a gagné d’autres et le panier moyen est monté. On a commencé à 200 000 euros de chiffre d’affaires, on est à 250 000 », note Félix Martin.
Il est convaincu qu’il y aurait de la place pour d’autres fermes dans l’agglomération. L’accès aux terrains et à l’eau est évidemment une difficulté, mais les territoires urbains ont une ressource abondante qui manque à la campagne : la main-d’œuvre. « On a toujours plus de candidats que de postes à pourvoir. Je sais que certaines fermes se plaignent des ouvriers qui partent du jour au lendemain, mais ici ils restent, assure Félix Martin. C’est sans doute parce qu’ils se sentent bien. On leur laisse de l’autonomie dans leur travail, on écoute leurs propositions… Ils sont respectés. Ce n’est pas toujours le cas dans le milieu agricole. »
Son confrère Philippe Zerr approuve : « Avec le recul, je trouve que le principal intérêt de nos fermes, c’est que ça permet de convertir des urbains dans les métiers de l’agriculture. » Alors que la moitié des agriculteurs en France vont partir à la retraite dans les prochaines années et que les candidats à la reprise manquent, il est convaincu lui aussi que « les viviers sont en ville. L’agriculture urbaine, c’est un palier : on peut l’exercer sans faire déménager sa famille et quitter ses relations ». Un saut qu’il se sent désormais prêt à franchir : il envisage de reprendre une ferme à une heure de Lyon.